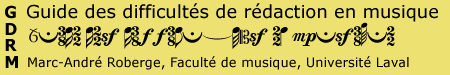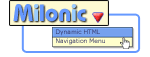- Forme correcte ✓
- Forme fautive ✕
- Exemple ➨
Guides > Planification d'une carrière en musicologie
La présente page regroupe des suggestions de stratégies à adopter afin de planifier une carrière dans le monde de la musicologie (voir la page What is musicology? sur le site de l'American Musicological Society).
- Généralités
- Études
- Utilisation des ressources documentaires
- Contacts avec le milieu
- Mémoires, thèses et publications
- Technologie et édition
Bibliographie (voir aussi les ouvrages suggérés à la section Publications dérivées de mémoires et de thèses)
Berdahl, Loleen, et Jonathan Malloy. Work Your Career : Get What You Want from Your Social Sciences or Humanities PhD. Toronto : University of Toronto Press, 2018. 208 p.
Furstenberg, Frank F. Behind the Academic Curtain : How to Find Success and Happiness with a PhD. Chicago Guides to Academic Life. Chicago : University of Chicago Press, 2013. 208 p.
Goldsmith, John A., John Kolmos et Penny Schine Gold. The Chicago Guide to Your Academic Career. Chicago Guides to Academic Life. Chicago : University of Chicago Press, 2001. 272 p.
Krieger, Martin H. The Scholar's Survival Manual : A Road Map for Students, Faculty, and Administrators. Bloomington et Indianapolis : Indiana University Press, 2013. xxxi, 380 p.
Nattiez, Jean-Jacques [professeur émérite lde la Faculté de musique de l'Université de Montréal]. Profession musicologue. Collection « Profession ». Montréal : Les Presses de l'Université de Montréal, 2007. 72 p.
Verba, Cynthia (adapté pour l'American Musicological Society par Cynthia Verba et Richard Crawford). The Ph.D. and Your Career : A Guide for Musicologists. President and Fellows of Harvard College, 1980. 36 p. Version révisée sous le titre de For Graduate Students in the Fields of Music : A Guide to Professional Development, 2011. vii, 188 p.
Wells, Elizabeth A. [professeur d'histoire de la musique à la Mount Allison University (Sackville, N.-B.)]. The Organized Academic : How to Transform Your Academic Life. Lanham : Rowman & Littlefield, 2022. xxi, 105 p.
Généralités
Passion : Identifiez et développez une passion pour un répertoire ou un domaine du savoir qui vous amènera à vouloir tout lire, tout voir et tout entendre, et à être constamment à l'affût des nouveautés dans un domaine particulier (livres, partitions, disques, concerts). Assistez le plus souvent possible à des concerts.
Développement des connaissances : Comblez sans tarder les lacunes de votre formation par des lectures et des auditions (avec la partition), car vous devrez probablement vous soumettre au début de votre doctorat à une série d'examens de synthèse qui mettront vos connaissances à rude épreuve.
Planification des études : Cherchez à développer un intérêt très fort dans un domaine particulier du savoir avant de commencer votre maîtrise ou votre doctorat, ce qui vous permettra d'identifier plus facilement un directeur de recherche, un établissement d'enseignement et un domaine de recherche. Rédigez pour votre demande d'admission un texte concis, clair et impeccable faisant état de vos intentions. Ce document vous sera aussi utile pour vos demandes de bourses et vous forcera à formuler des intentions souvent vagues à ce stade.
Polyvalence : Malgré l'importance de la spécialisation dans les études supérieures, pensez à développer une polyvalence, qui est souvent requise dans de plus petites facultés ou dans des facultés qui n'offrent pas de diplômes de deuxième et troisième cycles, où l'on pourra vous demander de donner des cours dans diverses matières.
Plan de carrière : Élaborez rapidement un plan de carrière tenant compte des besoins du marché (besoins des facultés, retraites à venir, nouvelles tendances).
Débouchés : Les études en musicologie peuvent mener à diverses carrières, qu'il s'agisse de musicologie historique ou théorique visant tant la musique de tradition savante que la musique populaire ou encore de recherche-création :
- Enseignement et recherche à l'université (incluant le remplacement pendant les années d'étude et de recherche des personnes en poste)
- Enseignement de la littérature musicale au cégep (au Québec)
- Bibliothéconomie (moyennant une maîtrise dans le domaine)
- Rédaction de notes de programme et de livrets de disques
- Révision de textes pour des maisons d'édition
- Édition musicale (livres, partitions)
- Traduction
- Critique
- Journalisme
- Archivistique
- Muséologie
- Production d'émissions de radio ou de télévision
- Administration de sociétés de chercheurs ou de concerts
Études
Demandes d'admission : Avant de préparer une demande d'admission dans une université, consultez le site Web de la faculté dans laquelle vous souhaitez étudier afin de prendre connaissance des divers programmes et concentrations afin de cibler ce qui correspond à votre projet. Renseignez-vous sur les professeurs en poste et leurs domaines de recherche. N'hésitez pas à contacter et, idéalement, à rencontrer la ou les personnes avec lesquelles vous souhaiteriez travailler pour obtenir, si possible, un accord de principe. Évitez de procéder uniquement par courriel. Fournissez une lettre de motivation qui traitera des points suivants :
- raisons pour lesquelles vous posez votre candidature à un programme de deuxième ou troisième cycle dans le domaine;
- objectifs de carrière poursuivis;
- domaine ou projet de recherche, en donnant des précisions sur la méthodologie ou la démarche;
- aptitudes particulières pour le domaine ou le projet et réalisations pertinentes.
Si vous faites une demande pour des études dans un pays étranger (dans la langue duquel vous devriez avoir les connaissances suffisantes pour faire les études souhaitées), fournissez des explications sur le contenu des cours pertinents que vous avez suivis (histoire de la musique, musicologie, méthodologie, introduction à la recherche, analyse, etc.). Envoyez aussi des plans de cours qui permettront aux directions de programme de comparer votre préparation à ce que leur établissement ou des établissements du même type dans le pays proposent. Soyez prêts à soumettre des copies de travaux récents à l'appui de votre demande si on vous le demande. Attendez-vous à ce qu'on vous impose une scolarité préparatoire si votre formation n'est pas jugée suffisante.
Bourses : Renseignez-vous le plus rapidement possible sur les bourses d'études offertes par les départements et les organismes subventionnaires pour soumettre des demandes dans les délais prescrits. N'oubliez pas de prévoir qu'il vous faudra identifier les personnes susceptibles d'écrire de bonnes lettres de recommandation et leur donner assez de temps pour les rédiger. Il arrive trop souvent que des étudiants se réveillent à la dernière minute en demandant une lettre quelques jours avant l'échéance.
Maîtrise des langues : La maîtrise la plus parfaite possible de l'anglais est une condition fondamentale pour effectuer des études supérieures (voire des études de premier cycle). Consacrez si nécessaire toute l'énergie requise à l'étude de cette langue dès le début de vos études de baccalauréat. Étudiez aussi d'autres langues qui seront essentielles à vos recherches (par exemple allemand, italien, latin) et cherchez à acquérir les bases d'autres langues importantes, ce qui vous permettra d'accéder à une documentation plus vaste. Même une simple familiarité avec les signes diacritiques d'une langue, qui permet d'identifier rapidement les mots, peut être utile. Un intérêt pour les civilisations concernées sera un atout considérable pour la compréhension des langues.
Lieux d'étude : Résistez à la tentation de faire toutes vos études (baccalauréat, maîtrise, doctorat) dans le même établissement d'enseignement. Les comités de sélection des facultés de musique pourraient vous reprocher d'avoir une perspective limitée et choisir d'autres candidats pour éviter ce qu'on appelle la « consanguinité ». Essayez d'étudier dans au moins deux universités, de préférence dans d'autres pays et d'autres langues, et ainsi découvrir de nouvelles approches, être en contact avec des personnes différentes et profiter de ressources documentaires pleinement adaptées à votre projet.
Emplois : Postulez rapidement comme correcteur ou assistant de cours (angl. teaching assistant) ou de recherche. Les chercheurs qui obtiennent des subventions de recherche prévoient généralement des postes budgétaires pour l'engagement d'assistants. Ce type de travail vous permettra d'acquérir une expérience pertinente et sera un atout pour les demandes de bourses. En retour, celles-ci vous aideront à réduire le temps consacré à des emplois qui contribuent peu ou pas à vos études et en retarderont souvent l'achèvement.
Diplomation : Concentrez vos efforts afin d'obtenir votre diplôme le plus rapidement possible, car les personnes qui ont déjà terminé leurs études obtiendront les rares postes offerts dans votre domaine.
Études postdoctorales : Il est de plus en plus fréquent, voire souhaitable, de faire des études postdoctorales (familièrement appelées postdoc) après avoir obtenu son Ph. D. Il s'agit d'une période pendant laquelle un chercheur en début de carrière s'associe, pendant quelques mois (ou années), à une université ou un centre de recherche où il peut faire de la recherche, souvent au sein d'une équipe, tout en profitant de l'environnement intellectuel et des ressources qu'offre le lieu d'accueil. Des tâches d'enseignement, la participation à des séminaires, etc. peuvent également être incluses. Il est possible d'obtenir des bourses pour effectuer ces stages. Les études postdoctorales augmentent les chances d'obtenir un poste menant à la permanence (angl. tenure-track position).
Attitude généraliste : Même si les études de maîtrise et de doctorat visent à former des spécialistes, il faut aussi être un généraliste accompli. Il est fréquent, surtout en début de carrière, d'avoir à donner des cours en dehors de son domaine précis de spécialisation, particulièrement dans des départements de petite taille.
Impact financier sur la retraite : Retardez le moins possible votre entrée en carrière, car toute année perdue aura un impact financier sur votre régime de retraite.
Utilisation des ressources documentaires
Lectures : Lisez (ou du moins parcourez) beaucoup de livres et d'articles spécialisés, et ce, sans négliger les sujets situés en dehors de votre champ d'intérêt immédiat. Vous devez connaître l'état de la recherche dans votre domaine.
Nouvelles acquisitions : Parcourez régulièrement le rayon des nouvelles acquisitions à la bibliothèque pour découvrir les nouvelles parutions et les pratiques du monde de l'édition. Consultez aussi la liste New Books in Musicology sur le site de l'American Musicological Society.
Périodiques courants : Consultez les derniers numéros des principaux périodiques spécialisés, qu'ils soient en version papier ou en ligne, pour découvrir les auteurs, les sujets traités, les nouvelles approches, les débats, etc. Portez une attention spéciale aux pages de publicité, le cas échéant, pour découvrir les dernières parutions.
Comme les bibliothèques remplacent de plus en plus les périodiques papier par leurs équivalents en ligne, il est devenu difficile de feuilleter les nouvelles parutions en se rendant à la bibliothèque. Il faut consulter les sites des éditeurs de revue pour avoir accès à la table des matières (ce que donnent de plus en plus les catalogues de bibliothèques), mais penser à le faire régulièrement, et ce, pour chacune des revues dont on veut suivre le contenu. Ainsi, la transition du format papier au format électronique, qui devait faciliter l'accès, peut paradoxalement le rendre plus difficile. Ne pas effectuer de vérifications fréquentes amène malheureusement à ignorer l'existence de publications pertinentes ou encore à les découvrir en retard.
Une façon de contourner le problème est de consulter régulièrement les résumés des numéros courants dans le JournalTOCS (School of Mathematical and Computer Sciences, Heriot-Watt University, Édimbourg) en choisissant le groupe Music dans la catégorie Art (171 périodiques en date du 8 avril 2025).
Contacts avec le milieu
Concours et prix : Inscrivez-vous aux concours de rédaction d'articles et de communications organisés par les sociétés de chercheurs pour constituer rapidement un dossier de publications et de réalisations et vous faire connaître. Cela vous sera très utile pour vos demandes de bourses.
Lectures sur la carrière universitaire et les activités de publication : Lisez des ouvrages généraux sur la préparation à la carrière universitaire et sur les années menant à la permanence. Le lien fourni dans le paragraphe d'introduction donne la bibliographie pertinente.
Sociétés savantes : Fréquentez les sites des associations de musicologues pour profiter des ressources offertes, en particulier les annonces relatives aux colloques et aux postes à pourvoir. Devenez membre dès le début de vos études et assistez régulièrement aux colloques. Vous découvrirez les attentes des professionnels du domaine, vous les rencontrerez et, surtout, vous vous ferez connaître d'eux.
- American Musicological Society (AMS)
- MusCan, autrefois Société de musique des universités canadiennes (SMUC)
- Observatoire interdisciplinaire de création et de recherche en musique (OICRM)
- Société québécoise de recherche en musique (SQRM)
- Société française de musicologie
Colloques : Parcourez régulièrement les listes de colloques et leurs programmes pour découvrir les grands sujets qui intéressent les chercheurs. Vous pourrez ainsi planifier des projets de recherche en lien avec les priorités du moment.
- American Musicological Society; voir les programmes préliminaires des congrès annoncés sur la page principale du site.
- J. P. E. Harper-Scott (Royal Holloway, University of London), Golden Pages for Musicologists : Forthcoming conferences (voir aussi la page Conference archive).
- MusCan; voir la page Colloque annuel.
- Music Conferences Worldwide
- Society for Music Theory; page Upcoming Events.
Groupes de discussion : Participez aux groupes de discussion du domaine ou du moins suivez-les pour être rapidement au courant des nouveautés, des colloques, des débats et controverses, des préoccupations, etc.
- American Musicological Society, sur Humanities Commons
- Épistémuse (Réseau international des musicologies francophones)
- musiSorbonne (voir les données de fonctionnement à la page Nicolas Meeùs — Documents divers)
Bibliothèque de partitions : Consultez les sites de bibliothèques et autres ressources qui offrent des fichiers électroniques de partitions libres de droits afin d'ajouter facilement et sans frais à votre collection de partitions ou à répondre à des besoins de recherche spécifiques.
- The Henselt Library : Public domain scores of rare nineteenth-century piano music
- International Music Score Library Project/Petrucci Library (IMSLP)
- UR Research (Sibley Music Library, Eastman School of Music, University of Rochester)
Correspondance avec les chercheurs : Écrivez à des musicologues spécialistes de votre sujet de recherche et qui pourraient vous apporter de l'aide. N'oubliez cependant jamais d'identifier soigneusement votre démarche et de la contextualiser afin de vous donner de la crédibilité; fournissez aussi tous les détails permettant au correspondant de vous répondre avec le plus de précision possible. Votre lettre sera ainsi beaucoup mieux reçue et aura plus de chances d'obtenir une réponse. Créez-vous rapidement un réseau international de contacts, ce qui pourra vous valoir des invitations à faire une présentation lors d'un colloque.
Mémoires, thèses et publications
Planification : Commencez dès le baccalauréat à lire des ouvrages sur la rédaction d'une thèse et la rédaction savante afin de planifier les années à venir, en d'autres mots, de savoir à quoi vous attendre.
Ampleur : Un mémoire de maîtrise ou une thèse de doctorat, quelle que soit son importance, ne doit pas devenir l'œuvre de votre vie et accaparer vos énergies pendant une période trop longue. Retarder votre diplomation risquerait de vous faire perdre tout intérêt pour votre sujet, sans parler de votre motivation. Un mémoire de maîtrise fait habituellement environ 125 pages, et une thèse de doctorat autour de 350. Résistez à la tentation de donner à un mémoire l'ampleur d'une thèse, sous peine d'être rapidement submergé et de retarder indûment la fin de vos études et votre entrée sur le marché du travail. De nombreux comités d'évaluation de mémoires de maîtrise doivent rappeler aux candidats qu'ils ont soumis un projet de taille suffisante pour un doctorat et qu'ils doivent se limiter à une question précise. Il est toujours possible de revenir aux sujets qui débordent les limites du projet dans des articles.
Délimitez votre sujet de façon très serrée, car l'étude détaillée d'un sujet prend toujours des proportions que l'on ne soupçonnait pas au départ. De plus, vous devrez vivre avec votre sujet pendant quelques années. En fait, le choix d'un sujet de thèse s'apparente au choix d'un conjoint, car on vit constamment avec ce sujet (et on fait vivre cette personne avec ce sujet).
Répertoires : Pour des compilations de thèses, voyez en particulier les publications ou bases de données suivantes.
- EthOS e-theses online service (British Library)
- Pistone, Danièle. Répertoire des thèses françaises relatives à la musique (1810-2011), Musique — Musicologie, vol. 44. Paris : Honoré Champion Éditeur, 2013. 514 p.
- Proquest. Dissertation Express.
- TEL (Thèses en ligne), Centre pour la Communication Scientifique Directe
- theses.fr (Agence bibliographique de l'enseignement supérieur) {répertorie aussi les thèses en cours}
Publications dérivées de mémoires et de thèses : Planifiez vos travaux de manière à pouvoir les transformer en communications ou en articles. Une partie plus ou moins substantielle d'une thèse de doctorat pourra donner lieu à une série d'articles ou à des contributions à des ouvrages collectifs. Un mémoire ou une thèse est une épreuve initiatique conçue pour satisfaire les exigences d'un diplôme et écrite pour être lue par un groupe de chercheurs dont la tâche est de l'évaluer. Il ne s'agit pas d'un texte qui s'adresse à un public plus large sans avoir fait l'objet de modifications radicales. Une publication sous forme de livre peut exiger une réécriture à peu près complète; peu d'éditeurs voudront publier un travail avec un appareil critique aussi lourd et conçu pour un lectorat dont les attentes sont très différentes.
La publication d'articles au cours de vos premières années de carrière est essentielle pour votre engagement puis pour votre promotion (« publish or perish »). Ces publications se font normalement dans des revues dites « avec comité de lecture » (angl. refereed journals, peer-reviewed journals), lesquelles s'adressent à un public très ciblé. Vous devez donc accepter que vos textes, comme votre mémoire ou votre thèse, ne rejoindront souvent qu'un lectorat bien limité. Les communications savantes présentées dans les colloques constituent une autre exigence de la carrière universitaire.
- Belcher, Wendy Laura. Writing Your Journal Article in Twelve Weeks : A Guide to Academic Publishing Success. 2e éd. Chicago Guides to Writing, Editing, and Publishing. Chicago : The University of Chicago Press, 2019. 368 p.
- Cossette, Pierre. Publier dans une revue savante : Les 10 règles du chercheur convaincant. 2e éd. Montréal : Presses de l'Université du Québec, 2016. 170 p.
- Derricourt, Robin. An Author's Guide to Scholarly Publishing. Princeton : Princeton University Press, 1996. 264 p.
- Forget-Dubois, Nadine. Écrire un article scientifique en anglais : Guide de rédaction dans la langue de Darwin. Québec : Presses de l'Université Laval, 2016. 154 p.
- Germano, William. From Dissertation to Book. Chicago Guides to Writing, Editing, and Publishing. 2e éd. Chicago : University of Chicago Press, 2013. 184 p.
- Germano, William. Getting It Published : A Guide for Scholars and Anyone Else Serious about Serious Books. Chicago Guides to Writing, Editing, and Publishing. 3e éd. Chicago : University of Chicago Press, 2016. 304 p.
- Ginna, Peter, dir. What Editors Do : The Art, Craft, and Business of Book Editing. Chicago Guides to Writing, Editing, and Publishing. Chicago : University of Chicago Press, 2017. 320 p.
- Harman, Eleanor, et al. The Thesis and the Book : A Guide for First-Time Authors. 2e éd. Toronto : University of Toronto Press, 2003. 176 p.
- Luey, Beth. Handbook for Academic Authors. 5e éd. Cambridge : Cambridge University Press, 2010. 276 p.
- Ochs, Michael. « What Music Scholars Should Know about Publishers ». Notes (Music Library Association) 59, no 2 (décembre 2002) : 288-300. [Project MUSE]
Il est difficile de résister ici à l'envie de citer le philosophe québécois Jacques Dufresne, qui parlait de revues « avec comité de lecture » pour les distinguer des revues « avec communauté de lecteurs »; « Les jeunes chercheurs et l'avenir du Québec selon Fernand Dumont », La Presse, 3 novembre 1990 : B3.
Aspect financier : Les publications savantes ne mènent pas à l'aisance financière, et encore moins à la richesse. Seuls les auteurs de manuels obligatoires achetés à chaque session dans de nombreux départements ou facultés, et qui sont réédités tous les cinq ans, lorsque la revente entre étudiants et sur le marché du livre d'occasion ne permet plus aux éditeurs de générer des revenus suffisants, peuvent accumuler un coussin. Vous n'aurez normalement guère plus qu'un ou plusieurs exemplaires gratuits de votre publication, une réduction de prix pour vos achats chez l'éditeur et la fierté bien légitime d'ajouter un titre à votre curriculum vitæ. Dans le cas de livres, on pourrait vous demander de renoncer à vos droits d'auteur ou encore de les obtenir à partir d'un deuxième tirage (ce qui relève le plus souvent du rêve). Vous aurez normalement dû fournir des exemples musicaux et des illustrations ou payer pour les faire préparer, ce qui s'ajoutera aux frais de recherche. Ces frais comprennent les photocopies, l'achat de livres et de partitions, les frais de reproduction parfois très élevés pratiqués par les grandes bibliothèques nationales et de recherche, les voyages, le paiement d'assistants de recherche, etc. Les organismes subventionnaires peuvent exiger que les articles résultant de recherches subventionnées soient publiés en libre accès (angl. open access), ce qui implique le paiement de frais très substantiels à couvrir par l'auteur.
Subventions de recherche : pour pouvoir réaliser des projets d'envergure, il faut obtenir rapidement des subventions de recherche (angl. research grants). L'obtention de subventions est une exigence fondamentale pour la promotion dans la carrière universitaire (agrégation et titularisation). Vous devez agir vite au cours des cinq premières années suivant votre premier engagement, période pendant laquelle vous serez considéré comme un « nouveau chercheur ». La qualité de votre projet sera alors normalement privilégiée par rapport au nombre et à la qualité de vos publications ; par la suite, ce sont vos réalisations qui prendront toute l'importance. Si vous avez obtenu des fonds et que les pairs consultés ont la preuve, par vos réalisations, que vous en avez fait bon usage, vous aurez de bonnes chances d'en recevoir d'autres; autrement dit, on ne donne qu'aux riches. La compétition est très féroce, et un refus ne signifie pas nécessairement qu'un projet est sans validité. Il s'agit plutôt d'une occasion de le revoir à la lumière des commentaires des évaluateurs et de le soumettre à nouveau l'année suivante.
On peut obtenir des subventions d'organismes comme le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) et le Fonds de recherche du Québec.
Pour une description du processus d'évaluation des demandes de subventions de recherche au Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, voir Murray Dineen, « How to Win at SSHRC », Intersections : Canadian Journal of Music, no 28/1 (2007) : 3-10.
ABD : L'abréviation anglaise ABD signifie « All But Dissertation », c'est-à-dire que l'on a rempli seulement les exigences menant à la rédaction de la thèse, à savoir la scolarité et les examens de synthèse. L'abréviation ne devrait toutefois pas figurer dans la description de ses réalisations, car elle indique que l'on n'est pas allé jusqu'au bout du processus. Justifier une interruption de programme est rarement chose facile auprès d'employeurs potentiels. Environ la moitié des candidats au doctorat se retrouveraient dans cette situation.
Technologie et édition
Préparation de documents prêts à imprimer : Maîtrisez les fonctions avancées des logiciels de traitement de texte afin de produire des résultats professionnels et idiomatiques. Vous pourrez ainsi répondre aux exigences du prêt à imprimer (angl. camera-ready copy) et de l'autoédition, qui peut s'avérer pertinente dans certains cas particuliers. La préparation de fichiers graphiques ou sonores appropriés peut être utile pour la publication d'articles en ligne, qui peuvent parfois accueillir ces éléments.
Outils logiciels : Développez une bonne connaissance des outils logiciels qui peuvent être utiles en recherche et en enseignement : gestion bibliographique, tableurs et bases de données, logiciels de présentation, éditeurs de partitions, analyse statistique, analyse sonore, etc.
Programmation Web (HTML, CSS) : Développez les connaissances nécessaires pour réaliser et gérer un site Web, ce qui vous permettra de préparer des outils complémentaires à une publication, comme des listes et des appendices considérés comme trop longs pour faire partie de l'ouvrage, ou un site présentant vos réalisations ou encore des recherches pour lesquelles les méthodes de diffusion habituelles dans le monde universitaire ne semblent pas appropriées.
Monde de l'édition : Intéressez-vous à l'édition pour naviguer facilement dans les activités de publication, qui occuperont une partie très importante de votre carrière.
Accueil | À
propos du site | Pages essentielles | Bibliographie
Aide | Plan du site | Liste alphabétique des noms de fichiers
Modifications
écentes et nouvelles | Commentaires | Au
sujet de l'auteur
Prix
pour la promotion d'une langue de qualité dans l'enseignement collégial
et universitaire
Gala
des Mérites du français 2003 de l'Office québécois
de la langue française
Le GDRM décline toute responsabilité quant à la validité et à la pérennité des liens Internet fournis
ainsi qu'à l'exactitude et au caractère des données qu'ils renferment.
© Marc-André Roberge 2026
Faculté de musique, Université Laval, Québec