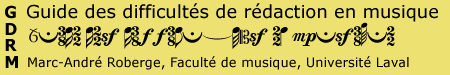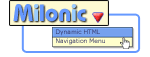- Forme correcte ✓
- Forme fautive ✕
- Exemple ➨
Guides > Programmes de concerts
La présente page répertorie les éléments devant ou pouvant être inclus dans chacune des parties d'un programme de concert ou d'opéra. Bien qu'il n'existe pas de règles absolues, l'étude de programmes bien conçus permet d'identifier certains principes et pratiques susceptibles de mener à la réalisation d'un programme idéal.
Il faut toujours vérifier soigneusement les données fournies par les interprètes, en particulier l'orthographe des noms et des titres. Il ne faut pas hésiter à revoir l'utilisation des majuscules et à compléter les titres avec les numéros d'opus et les années de composition. Comme ces données sont le plus souvent préparées et transmises par des personnes qui ne sont pas des spécialistes de la bibliographie ou de la typographie, il n'est pas possible d'éviter d'apporter les modifications nécessaires pour respecter le protocole de rédaction choisi.
On ne rappellera jamais assez l'importance de la lecture des épreuves par plusieurs personnes, et ce, dans plusieurs contextes permettant d'aborder le texte d'une façon différente (à table, au salon, etc.). Il ne faut pas tenir pour acquis qu'un élément, surtout s'il est composé en gros caractères, est correctement écrit; c'est souvent là que se produisent les erreurs les plus humiliantes. On doit se méfier des oublis qui peuvent survenir lors de la réutilisation du fichier d'un programme précédent; c'est toujours après l'envoi à l'imprimeur, ou lors de la réception de la commande, que l'on réalise avoir oublié les vérifications les plus élémentaires. La page Typographie > Techniques de lecture d'épreuves fournit plusieurs suggestions pertinentes. La liste suivante pourra également être utile.
- Uniformité
- Mentions en gros caractères et titres de sections
- Dates (correspondance avec le jour de la semaine) et heures, nom de la salle
- Numéros de pages dans la table des matières
- Crédits photographiques
- Logos des commanditaires
- Publicités
- Remerciements
- Liste des donateurs à jour
- Noms des artistes et des compositeurs ou auteurs : orthographe (incluant le respect des signes diacritiques) et (au besoin) années de naissance et de mort
- Titres des œuvres : orthographe, majuscules, italique, numéros d'opus de catalogue, années de composition
Couverture
- Nom de l'organisme
- Nom du concert
- Contexte dans lequel est présenté le concert
- Noms des interprètes
- Indication détaillée du lieu
- Date et heure {On doit fournir non seulement
le jour et le mois, mais aussi l'année, donnée
essentielle pour l'archivage et, ultérieurement, pour la recherche
sur l'histoire de l'organisme ou sur la vie musicale de la ville ou de l'époque.
L'article le ne s'utilise que lorsque la date fait partie
d'une phrase. Les zéros de minutes sont omis pour les heures justes.}
➨Mardi 15 février 2022, 19 h 30
➨Mardi 15 février 2022, 20 h
➨Du 14 au 18 février 2022
➨14, 16, 18 février 2022
Reliure
Agrafage à cheval : Les organismes qui ne peuvent pas s'offrir des services professionnels d'impression et de reliure et qui remettent des programmes photocopiés devraient toujours au moins utiliser l'agrafage à cheval et non simplement un groupe de feuilles pliées. Ceci permet d'éviter que des feuilles se détachent ou produisent du bruit lors de la manipulation. Les photocopieuses utilisées dans les commerces spécialisés permettent d'imposer, de plier et d'agrafer automatiquement les pages à partir de fichiers PDF.
Préparation de fichiers prêts à photocopier : On peut préparer un fichier prêt à imprimer au moyen de la fonction Disposition Livre que l'on trouve sous Fichier | Marges | Pages dans Microsoft Word (Créer un livret ou un livre).
Intérieur
Emplacement de la liste des œuvres au programme : Afin d'éviter aux spectateurs de devoir tourner plusieurs pages pour trouver la liste des œuvres (et ainsi déranger les autres), il est préférable de placer toutes ces informations au début du programme ou au centre d'une reliure brochée à cheval, ce qui permet un accès facile.
Identification des compositeurs par leur nom complet : Les noms doivent être écrits en entier (c'est-à-dire sans abréger les prénoms), et ce, dans l'ordre normal (prénom nom). Il est malhabile de publier un programme de saison où tous les noms de compositeurs sont abrégés, surtout lorsqu'on souhaite faire une place à des créateurs vivants peu connus ; de plus, la documentation doit être aussi claire pour les néophytes que pour les habitués, et il est peu probable que le manque d'espace suffise comme justification. Si donner les prénoms pour les noms peu connus et se limiter aux noms de famille pour les figures célèbres peut sembler une solution acceptable, l'uniformité du document s'en trouvera compromise, sans compter que cela amènera à faire des jugements de valeur. Une conception graphique soignée permet toujours d'avoir l'espace requis pour accommoder des noms écrits au long.
L'inversion des noms (nom, prénom) ne convient pas à un programme de concert, car il ne s'agit pas ici d'une liste alphabétique, mais simplement d'une énumération de noms placés dans un ordre relevant du choix artistique ou esthétique. De plus, il faut utiliser avec parcimonie le mélange de prénoms en minuscules et de noms en majuscules, qui n'a pas sa place dans un texte suivi.
✓Ludwig
van Beethoven
✓Ludwig
van BEETHOVEN {jamais dans du texte suivi}
✕L. van Beethoven
✕L. van BEETHOVEN
✕Beethoven,
Ludwig van
✕BEETHOVEN,
Ludwig van
Police : La police choisie doit permettre d'utiliser correctement les signes diacritiques requis (autres que ceux du français) tant sur les majuscules que sur les minuscules. Certaines polices peuvent ne pas posséder les caractères requis, ce qui obligera le logiciel à utiliser des substitutions inesthétiques, avec ici et là des lettres légèrement plus petites ou plus grosses.
✓Béla Bartók, Leoš Janáček, Witold Lutosławski
✕Bela Bartok, Leos Janacek, Witold Lutoslawski
Années de naissance et de mort : Il est important de fournir les années de naissance et, le cas échéant, de mort. Pour les compositeurs vivants, il est nettement préférable d'utiliser né en plutôt que le trait d'union ou le tiret ouvert. Les espaces réservés à une éventuelle année de mort ne conviennent pas non plus.
✓(né
en 1950)
✕(1950-)
✕(1950- )
Une pratique courante consiste à aligner à droite, à raison d'un élément par ligne, le nom du compositeur et les années.
Œuvres attribuées à d'autres compositeurs : Lorsqu'on veut indiquer que l'identité du compositeur d'une œuvre n'est pas clairement établie et qu'on l'attribue à une personne donnée, on ajoute les mots Attribué à avant le nom concerné. Si le nom doit apparaître de façon inversée, par exemple dans une compilation, on placera les mots après le nom.
➨Attribué à Giovanni Paisiello
➨Paisiello, Giovanni (attribué à)
➨Paisiello, Giovanni (attrib.)
Selon le contexte, d'autres formulations permettant d'exprimer des doutes sont possibles :
➨authenticité douteuse {angl. spurious ou doutbful authenticity}
➨faussement attribué à
Titres des œuvres : Toutes les pages du GDRM dans le menu « Titres » pourront être utiles pour présenter les titres selon des normes reconnues. Il ne faudra d'ailleurs pas hésiter à réviser les titres fournis par les interprètes en fonction du protocole choisi et à les compléter au besoin. Il convient d'utiliser les règles modernes concernant l'utilisation des majuscules dans les titres d'œuvres. En d'autres termes, seuls les noms propres et les autres mots exigent une majuscule pour ne pas enfreindre une règle. La pratique la plus courante consiste à aligner les titres à gauche. Les années de composition doivent toujours être indiquées, habituellement entre parenthèses.
Particularités de l'exécution : On indique si l'exécution présentée est une création ou encore une première européenne, nord-américaine, française, canadienne, québécoise, etc. Les expressions ✕création mondiale et ✕première mondiale sont des pléonasmes, car une ✓création est toujours la première exécution publique. Les médias offrent plusieurs exemples d'utilisation abusive de l'expression grande première pour toute représentation très attendue, notamment lorsqu'elle est offerte par un artiste aimé du public. La neuvième édition du dictionnaire de l'Académie définit première comme « ce qui constitue un évènement, une réussite sans précédent dans un domaine donné », et le Larousse comme un « événement important et original dans un domaine quelconque ».
Parties d'une œuvre et indications de tempo : Il est essentiel de reproduire la liste des titres qui composent les œuvres au programme, et cela est encore plus important si l'ordre diffère de la partition. Dans ce cas, il convient de fournir les explications pertinentes dans une note ou dans le programme, voire les deux. Si les titres doivent être brièvement projetés sur un écran, tout changement par rapport au programme annoncé doit avoir été communiqué pour que le fichier puisse être ajusté en conséquence.
La subordination de chacune des parties d'une œuvre ou les indications de tempo sont marquées par un léger renfoncement, un tiret court ou un point vignette (ou les trois). Le trait d'union (collé ou non) n'est jamais utilisé, car il sert à relier des mots composés et non à mettre en valeur les éléments d'une liste; cette pratique typographique paresseuse n'a pas sa place dans un travail soigné.
➨Mädchenlieder,
op. 103 [Robert Schumann]
– Mailied
– An die Nachtigall
– An den Abendstern
Durée : Dans le cas d'un opéra, il est souhaitable d'indiquer la durée de la représentation, entractes inclus, et ce, en en précisant le nombre et la durée. On peut aussi préciser la durée des actes. Les spectateurs apprécieront aussi que l'information figure sur le site Web de l'organisme, ce qui les aidera à anticiper la question du stationnement et éviter les mauvaises surprises avec les parcomètres.
➨Durée : 1 h 50 (sans entracte)
➨Durée : 3 h 20 (incluant 2 entractes de 20 minutes)
➨Acte 1 : 1 h 10, acte 2 : 50 min; acte 3 : 1 h 20 (avec 2 entractes de 20 minutes)
Entracte : Le moment de l'entracte est indiqué à l'endroit approprié, avec une typographie qui permet de le repérer aisément, par exemple en italique et centré. Il est également recommandé d'indiquer leurs durées respectives. Le mot ✕intermission est un anglicisme au sens d' ✓entracte (GB interval; US intermission); le mot ✕pause n'est pas approprié.
Radiodiffusion : On fournit les détails relatifs à une radiodiffusion en direct ou en différé (station, indicatif, date, nom de l'émission).
Instruments joués par les musiciens : Lorsqu'on mentionne le nom d'un musicien dans un contexte de liste ou d'affiche, il est préférable de le faire suivre du nom de son instrument plutôt que de la désignation en « iste » qui en est dérivée, ceci afin d'éviter les formes moins heureuses. Il n'y a pas de ponctuation après ce type de mention. Lorsqu'il est question des voix (soprano, alto, ténor, basse), on ne peut évidemment pas éviter la juxtaposition des deux types de désignations. Selon le contexte, il est possible d'utiliser direction plutôt que chef(fe) d'orchestre.
✓Marc-André
Hamelin, piano
✕Marc-André
Hamelin, pianiste
✕Marc-André
Hamelin, pianiste
Avertissements : L'expérience montre que les avertissements relatifs à l'utilisation intempestive de la technologie, aux applaudissements et aux retards sont de plus en plus pertinents. Le désagrément résultant des sonneries ou des bips est devenu une plaie qui affecte l'ensemble des personnes présentes. Il ne faut donc pas voir ces avertissements, ou une mise en évidence typographique permettant un repérage facile dans un programme, comme une insulte à l'endroit des spectateurs, mais comme ce qu'ils sont : un moyen de favoriser un contexte favorable pour l'ensemble de l'auditoire.
Il est facile de diffuser un avis au moyen d'un message enregistré diffusé dans les minutes précédant le concert. Il est également possible de faire entendre une forte sonnerie de téléphone avant le début d'un concert afin d'attirer l'attention, puis de diffuser aussitôt un rappel approprié. Les formulations suivantes, qui dépassent le problème des téléphones portables, pourront servir de modèles.
➨Le
public est prié de désactiver la sonnerie des montres numériques,
des téléavertisseurs et des téléphones portables.
➨L'utilisation
d'appareils photographiques, de magnétophones et de magnétoscopes
est strictement interdite.
➨Le
public est prié de ne pas applaudir entre les mouvements ou les parties
d'une œuvre.
➨Le
public est prié de ne pas faire de bruit avec les programmes ou tout
autre type de papier. {On peut espérer que
les personnes qui semblent prendre plaisir à déballer des bonbons
et ensuite à en plier, déplier et replier sans cesse l'emballage
comprendront à quel point le silence est une marque de respect pour
ses voisins.}
➨Le
public est prié de faire preuve de considération pour les musiciens
ainsi que pour les autres membres du public [et les auditeurs de la diffusion radio].
➨Les
retardataires ne pourront entrer qu'à un moment jugé opportun
par le personnel.
➨Le
public est prié de quitter la salle pendant les entractes.
Lisibilité : La graisse des caractères doit être assez épaisse, le corps assez gros et l'interligne assez grand pour permettre une lecture facile par toutes les catégories d'âge, et ce, dans des conditions d'éclairage souvent insuffisantes. De plus, il faut que le contraste entre le texte et la page soit bien marqué, surtout avec une couleur autre que le blanc. Il est essentiel de toujours garder à l'esprit l'équilibre entre la forme et la fonction, et de faire en sorte que le contenant mette en valeur le contenu.
Éclairage : La moyenne d'âge du public est souvent élevée, et de nombreux spectateurs peuvent éprouver des difficultés à lire un programme dans des conditions qui ne sont pas idéales. Il est donc essentiel de demander aux responsables des salles de spectacle de garantir un éclairage suffisant, idéalement avant le concert et pendant les entractes. À moins qu'il ne s'agisse d'un opéra ou d'un spectacle pour lequel les décors et l'éclairage de scène exigent une salle plongée dans l'obscurité, il devrait toujours y avoir un éclairage raisonnable pendant un concert. C'est particulièrement important si des textes chantés sont distribués, que ce soit dans la langue d'origine ou en traduction, ou encore les deux. Il s'agit également d'une marque de respect envers le public et les personnes responsables de la rédaction du programme.
Effets de lumière : Dans le cas d'une représentation faisant appel à des effets de lumière pouvant être incommodants (p. ex. lumière stroboscopique), il est préférable d'en avertir le public avant le lever du rideau. Afin de réduire le stress des personnes sensibles à ces effets, il convient de préciser dans quel(s) acte(s) ils sont utilisés.
Noms des membres d'un orchestre : La tradition veut que l'on commence la liste des noms des membres d'un orchestre par les cordes (de l'aigu au grave), puis on continue par ordre normal des instruments dans la partition jusqu'aux timbales et autres percussions. On termine avec les instruments supplémentaires (harpe, piano, célesta, etc.). Le nom de l'instrument (au singulier ou au pluriel, en fonction du nombre de musiciens) est mis en évidence par une typographie différente; les noms suivent par ordre alphabétique. Les noms des chefs de pupitre sont suivis de la mention solo, insérée entre parenthèses ou après une virgule, et de préférence en italique pour la mettre en évidence.
➨Pierre
Dupont, solo
➨Louise
Dupont (solo)
On peut aussi utiliser, au besoin, les termes surnuméraire et assistant. Il pourrait être également nécessaire d'ajouter une note en bas de page, dans un corps plus petit, précisant l'association syndicale des musiciens.
Noms des membres du chœur : On donne par ordre alphabétique les noms des membres du chœur sous les quatre catégories Sopranos, Altos, Ténors et Basses. Les pluriels italiens soprani et alti sont aujourd'hui démodés. Les noms des personnes responsables de la direction et des répétitions sont placés en haut de la liste, sous le nom de l'ensemble.
Autres listes : Si la chose est utile ou pertinente, on peut donner la liste des noms des administrateurs, du personnel technique de l'orchestre ou de la maison d'opéra, ainsi que des souscripteurs des campagnes de financement. Il est aussi possible d'annoncer les concerts à venir, de fournir des informations relatives aux matinées symphoniques, aux conférences préparatoires, etc.
Notes de programme : Les notes de programme (et non ✕notes-programme, notes du programme, notices de programme, notices programmatiques, annotations) ont pour but de :
- placer les œuvres au programme dans un contexte historique, social, artistique;
- attirer l'attention sur les circonstances de leur composition et sur les intentions du compositeur;
- identifier ce qui fait leur originalité et leur valeur particulière.
Les notes doivent être rédigées en tenant compte du public ciblé et de la nature du concert. Elles doivent pouvoir être comprises par le lecteur sans nécessiter de connaissances spécialisées et être lues avec plaisir par les spécialistes. Il est possible d'inclure quelques éléments techniques à condition qu'ils soient définis ou contextualisés. Enfin, il est généralement peu utile de régiger des notes très longues et détaillées, puisque le public aura peu de temps pour les lire, à moins qu'elles ne soient mises en ligne avant le concert pour permettre au public de se préparer et, idéalement, restent accessibles sur le site de l'organisme, ce qui sera très utile pour documenter son histoire. Il est possible que des spectateurs souhaitent relire le texte après le concert.
Les notes devraient toujours être signées ou se terminer par une notice de réservation des droits. Si l'auteur possède une expertise reconnue ou une affiliation qui donne de la crédibilité à ses propos, on peut ajouter une brève notice à la fin du texte, dans un corps plus petit.
On pourra consulter, particulièrement dans le contexte de notes préparées pour des examens, le guide suivant : Nigel Scaife, Writing Programme Notes : A Guide for Diploma Candidates (Associated Board of the Royal Schools of Music, 2001), 15 p.
Notices biographiques : Les notices biographiques (angl. artist's bios) soumises par les artistes ou leurs agents posent souvent de nombreux problèmes : longueur excessive; erreurs dans les noms de personnes, d'ensembles ou de titres; manque d'uniformité dans l'utilisation des majuscules; signes diacritiques omis ou malmenés. Comme l'uniformité est l'une des qualités essentielles d'une publication, un travail de révision et d'adaptation au protocole utilisé pour l'ensemble du programme est rarement évitable. Il n'est cependant pas exclu que l'agent exige d'approuver un texte abrégé ou révisé, voire un texte original.
Il est souvent préférable d'écrire des notices originales afin de respecter le nombre de mots permis. Ceci est d'autant plus nécessaire que les textes faisant partie du dossier fourni par les interprètes donnent de nombreux éléments sans grande importance pour le public qui dispose de peu de temps avant le concert : noms de collègues chambristes, d'orchestres et de chefs, de salles et de festivals, de concours et de prix, de rôles. Quiconque fait une carrière internationale se sera produit avec de nombreux orchestres connus (ou inconnus du public dans le cas d'interprètes avec une carrière plus modeste ou limitée géographiquement) et dans plusieurs salles réputées. Accumuler jusqu'à une vingtaine de noms ne rend service à personne et donne toujours l'impression de chercher à impressionner pour compenser l'absence de contenu pertinent concernant le rôle ou l'importance de l'interprète dans le monde musical.
Il est préférable de privilégier un texte informatif, qui évitera les excès de langage et les autocongratulations, pratiques trop faciles à une époque où l'autopromotion et la diffusion sur le Web sont devenues la norme. Trop d'artistes peu connus ou en début de carrière ont tendance à exagérer des réalisations encore modestes, sans se soucier de leur crédibilité. Il faut se méfier des articles publiés sur Wikipédia, qui reprennent parfois de façon presque intacte la documentation promotionnelle des artistes, à moins que ce ne soit l'inverse. Cette pratique contrevient d'ailleurs aux règles de l'encyclopédie, ce qui peut amener des réviseurs à ajouter des avertissements tels que « Le ton de cet article ou de cette section est trop élogieux, voire hagiographique » ou « Le ton de cet article ou de cette section est trop lyrique ou dithyrambique ». Cela se produit toutefois seulement si des Wikipédiens prennent le temps de se pencher sur les articles problématiques et savent comment signaler ces problèmes.
Dans le cas d'un programme d'opéra, on peut ajouter à la suite des noms, entre parenthèses, les noms des rôles tenus par les chanteurs et chanteuses. Une façon abrégée de préciser le nom de l'opéra dans lequel un personnage est présent consiste à fournir son nom suivi du titre de l'opéra séparé par une barre oblique (Bertarido/Rodelinda); cette pratique n'est pas encore très répandue, mais on peut la voir dans les brochures de certaines maisons d'opéra.
Textes et traductions : À moins de projeter des surtitres (angl. surtitles), utilisés pour la première fois en janvier 1983 par la Canadian Opera Company pour une production d'Elektra de Strauss, on peut reproduire les textes en les accompagnant d'une traduction (idéalement signée). Il faut alors s'assurer d'avoir obtenu les permissions requises ou encore que les textes fassent partie du domaine public. Si l'on propose deux traductions, on place le texte original au milieu afin de permettre à quiconque de jeter facilement un coup d'œil à l'autre traduction.
Il est également essentiel de fournir un éclairage suffisant pour permettre une lecture aisée. De plus, il se peut que l'on doive préparer une version imprimée des textes traduits pour les spectateurs qui sont assis à des places d'où ils ne peuvent pas lire les surtitres, soit complètement, soit pas du tout.
Identification des responsables du programme : On peut donner les noms des personnes responsables de la conception et de la réalisation du programme, particulièrement dans le cas de programmes particulièrement substantiels. Cette courte section, souvent composée en plus petits caractères et placée à la fin du programme, peut aussi contenir les sources des textes et des illustrations ainsi que l'identification des détenteurs des droits d'auteur.
Publicité : Des publicités regroupées dans une ou deux sections plutôt que réparties ici et là permettront une meilleure réalisation mise en forme typographique, mais auront moins d'impact que si elles avaient été vues pendant la lecture d'un texte.
Particularités des programmes d'opéra
Caractère élaboré : Les programmes réalisés pour des opéras sont généralement beaucoup plus élaborés que ceux destinés aux concerts et peuvent comporter une table des matières. Dans certains cas, généralement en Europe, il peut même s'agir de petits livres devant servir pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. On insère alors un feuillet de quelques pages fournissant la distribution et les informations pertinentes pour un groupe de représentations.
Liste des personnages : La liste des personnages peut être disposée en suivant l'ordre utilisé par le compositeur dans la partition ou en suivant l'ordre d'entrée en scène (ce qu'il faudra préciser le cas échéant). Quel que soit l'ordre choisi, il faut identifier les personnages et préciser les liens entre eux (sans hésiter à aller au-delà de ce qui est fourni dans la partition), comme dans l'exemple ci-dessous, tiré de Die Zauberflöte de Mozart. La présentation classique consiste à placer le nom du personnage à gauche, et le nom de l'interprète à droite, avec indication du registre de voix.
➨Tamino,
un prince égyptien
Papageno, un oiseleur
Monostatos, un esclave maure du palais de Sarastro
Sarastro, grand prêtre du temple d'Isis
[...]
Langue des noms de personnages : En règle générale, les noms des personnages des opéras en langue étrangère devraient être écrits dans la langue d'origine lorsqu'il s'agit de personnages fictifs, et dans la langue dans laquelle l'opéra est chanté dans le cas de personnages historiques dont les noms sont toujours traduits, comme ceux des souverains. Ainsi, en admettant que les opéras sont chantés dans la langue d'origine, on écrira de la façon suivante (les formes à éviter sont données entre parenthèses) :
- Arlecchino (Harlequin)
- Cherubino (Chérubin)
- Desdemona (Desdémone)
- Hänsel et Gretel (Jeannot et Margot)
- Lucia (Lucie)
- Isolde (Iseult)
En revanche, on dira :
- Moïse (Mosè)
- Philippe II (Filippo II [secondo])
Il y a aura toujours des cas limites, comme Elektra et Klytemnestra, dont les noms sont toujours donnés en français (Électre, Clytemnestre) lorsqu'il est question de tragédie grecque, mais qui chantent en allemand dans l'opéra de Richard Strauss.
À moins que cela ne paraisse ridicule ou déplacé, les auditeurs devraient lire dans un programme les noms entendus sur scène. Les équivalents français ont toute leur place dans une conversation ou dans un contexte non spécialisé. Cependant, les noms des personnages décrits dans la partition par leur fonction ou leur occupation ne doivent pas être reproduits dans la langue d'origine, mais dans la langue du programme. Ainsi, on écrira :
- Un héraut (Un araldo) dans Otello de Verdi
- Troisième esprit des bois (Third wood sprite) dans Rusalka de Dvořák
Cette précaution s'impose aussi dans les notices biographiques des interprètes.
Textes d'accompagnement : On peut retrouver parmi les textes une chronologie de la vie du compositeur, une liste de ses opéras, une série de citations pertinentes puisées le plus souvent dans ses écrits ou dans des sources contemporaines (lettres, critiques, etc.) ainsi que le livret complet (sous réserve d'autorisation des détenteurs des droits pour les textes qui ne sont pas dans le domaine public). À cet égard, il est important de garder à l'esprit que la traduction d'un libretto d'un opéra dans le domaine public fait encore le plus souvent l'objet de droits d'auteur.
Les maisons qui accueillent de nombreux spectateurs étrangers peuvent reproduire le résumé de l'intrigue dans une ou deux autres langues.
Illustrations : Les illustrations, souvent nombreuses, comprennent entre autres des portraits du compositeur, du librettiste, d'interprètes célèbres, ainsi que des reproductions d'anciennes mises en scène, d'esquisses ou de photos des décors et des costumes. Elles devraient toutes être munies de légendes fournissant la source de la documentation.
Remerciements : Compte tenu des ressources humaines requises pour une production, il convient de dresser, comme au cinéma, un générique permettant de remercier les personnes et compagnies qui ont apporté leur collaboration à la réalisation, aux décors, à la mise en scène, etc. Il est essentiel de faire réviser soigneusement cette section par une ou plusieurs personnes pour éviter les oublis ou les erreurs qui pourraient froisser les victimes.
Sites Web
Changements au programme : Les sites Web des organismes qui présentent des concerts ou des opéras devraient fournir les changements de programme (œuvres, annulations, remplacements de dernière minute, etc.) le plus rapidement possible. Tout feuillet inséré dans le programme pour tenir compte de ces changements devrait être révisé avec le plus grand soin d'autant plus qu'il doit souvent être préparé à la hâte.
Mise en ligne et archives : Les organismes devraient mettre en ligne leurs programmes dès que possible de manière à permettre aux membres du public de lire les textes à l'avance. L'ensemble des programmes aurait avantage à être et rester accessible en ligne, et ce, en remontant le plus loin possible, de manière à permettre des recherches sur les artistes et les œuvres jouées. Un module permettant d'interroger la base de données de l'organisme depuis ses débuts sera un outil très apprécié des chercheurs qui souhaitent documenter une exécution donnée.
Les organismes de concerts, les orchestres et les maisons d'opéra devraient laisser leur programmation en ligne, du moins pendant toute la durée de la saison, plutôt que de tout retirer ce qui n'a plus de pertinence pour la vente de billets.
Rappels : Comme trop d'artistes n'annoncent pas leurs rappels, considérant à tort que tous les auditeurs les reconnaîtront, ou le font dans une langue qui n'est pas celle du public, et ce, avec un volume si faible qu'on peut à peine les entendre, les organismes de concerts pourraient souhaiter fournir l'information sur leurs réseaux sociaux après le concert.
Étiquette du concert : Les organismes ne devraient pas hésiter à proposer une page sur les rituels et l'étiquette, particulièrement à l'intention des auditeurs qui en sont à leur première visite; plusieurs le font d'ailleurs déjà.
Accueil | À
propos du site | Pages essentielles | Bibliographie
Aide | Plan du site | Liste alphabétique des noms de fichiers
Modifications
écentes et nouvelles | Commentaires | Au
sujet de l'auteur
Prix
pour la promotion d'une langue de qualité dans l'enseignement collégial
et universitaire
Gala
des Mérites du français 2003 de l'Office québécois
de la langue française
Le GDRM décline toute responsabilité quant à la validité et à la pérennité des liens Internet fournis
ainsi qu'à l'exactitude et au caractère des données qu'ils renferment.
© Marc-André Roberge 2026
Faculté de musique, Université Laval, Québec