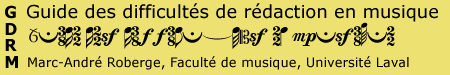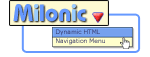- Forme correcte ✓
- Forme fautive ✕
- Exemple ➨
Guides > Étiquette du concert (musiciens, public)
La présente page consiste en un guide, non pas de rédaction, mais d'étiquette du concert, tant pour les musiciens que pour le public. Il propose des suggestions visant à permettre une expérience musicale réalisée dans les règles de l'art et qui soit la plus satisfaisante possible pour tous les participants.
Musiciens
Tenue vestimentaire
Les orchestres symphoniques et autres ensembles qui se produisent en public possèdent généralement leurs propres normes régissant la tenue vestimentaire en fonction des différents contextes de concerts (concerts réguliers, concerts d'été, festivals, etc.). Les suggestions relatives à la tenue vestimentaire, qui correspondent à des pratiques largement acceptées, seront particulièrement utiles aux musiciens faisant partie des orchestres de jeunes et d'étudiants, bien que les responsables de ces ensembles auront normalement établi des directives précises.
Les impairs vestimentaires sont d'autant plus visibles qu'ils sont imposés au spectateur sur une longue période. Il faut garder à l'esprit que le public d'un concert ou d'un opéra est presque aussi varié que la société elle-même, et que beaucoup de gens sont très sensibles à ces aspects.
Hommes
Habit (queue de pie; angl. tails), smoking (angl. tuxedo) ou complet-veston noir. Le pantalon noir avec une chemise noire sans cravate s'impose de plus en plus, particulièrement dans les orchestres de chambre et les orchestres jouant dans une fosse, comme d'ailleurs lors de récitals.
Chemise blanche à manches longues (idéalement conçue pour être portée avec un nœud papillon)
Nœud papillon noir (ou cravate noire dans le cas du complet-veston si le code vestimentaire de l'ensemble la préfère au nœud papillon)
Bas noirs et chaussures habillées noires, bien cirées, avec semelles discrètes et coutures non contrastantes
Erreurs de goût
- Chemise partiellement sortie du pantalon
- Chemise blanc crème ou beige, bas blancs
- Nœud papillon mal ajusté
- Jean noir ou pantalon mal coordonné avec le veston utilisé
- Bottes ou chaussures de sport
- Cheveux sales ou mal peignés
- Lotion après-rasage (qui pourrait incommoder les autres musiciens)
Femmes
Robe longue noire ou jupe longue noire sans fente (de légères fentes sont possibles, mais tout excès est un impair); les violoncellistes et les percussionnistes portent souvent des pantalons. Le pantalon noir avec blouse noire s'impose de plus en plus, particulièrement dans les orchestres de chambre et les orchestres jouant dans une fosse.
Blouse blanche avec manches trois-quarts ou plus, dans le cas du port d'une jupe
Bas noirs et escarpins avec bouts fermés et sans boucle contrastante, talons de hauteur modérée
Coiffure classique avec cheveux attachés de manière à ne pas nuire au jeu (les barrettes devraient être transparentes ou de la même couleur que les cheveux)
Erreurs de goût
- Robe ou jupe avec longues fentes, robe ou jupe courte
- Jean noir ou pantalon moulant
- Chaussures avec semelles compensées ou de couleur différente, chaussures de sport, bottes, souliers plats ou avec talons trop hauts
- Décolletés et dos plongeants
- Sous-vêtements apparents au-dessus des vêtements (avec ou sans mouvement des bras) ou à travers la blouse
- Bijoux autres que bagues et boucles d'oreilles discrètes
- Coiffure extravagante et couleurs non traditionnelles
- Accessoires brillants que l'éclairage intense pourrait rendre aveuglants ou distrayants
- Parfum et eau de toilette (qui pourraient incommoder les autres musiciens)
Souhaits de bonne chance
Les musiciens (comme des acteurs) se souhaitent souvent bonne chance en disant « Merde ». En allemand (et aussi en anglais), on dit « Toi, toi, toi » (se prononce comme le mot anglais toy). La personne à qui ce souhait est adressé ne doit jamais remercier son interlocuteur pour ne pas attirer ainsi la malchance. En anglais, une autre expression courante est « Break a leg », qui correspond à « toucher du bois ».
Annonces au public
Toute allocution ou brève présentation du concert ou des œuvres, qu'elle soit faite par les interprètes, les organisateurs du concert ou les commanditaires, doit avoir fait l'objet d'une préparation. Une improvisation est toujours risquée pour quiconque n'a pas l'habitude et ne maîtrise pas l'art oratoire. Il est trop facile de paraître ridicule lorsqu'on ne possède pas cette aisance naturelle. Le discours doit être délivré avec assurance, dans une langue simple et soignée, exempte de familiarités et d'humour douteux ou déplacé. Le désir de paraître moins strict et formel amène beaucoup de gens à alléger le ton et à recourir à l'humour, mais cela risque souvent de ne pas fonctionner, voire de véhiculer une mauvaise impression quant au professionnalisme de l'orateur. Il ne faut pas oublier que les sensibilités varient d'une culture à l'autre.
Il faut éviter de présenter un interprète dans des termes exagérément élogieux, voire carrément erronés (surtout pour un interprète en début de carrière), dans le but de lui faire plaisir ou d'éviter de le froisser ou encore de susciter l'adhésion du public. Si l'on doit présenter une personne dans plus d'une langue, il faut s'assurer de pouvoir le faire avec la maîtrise nécessaire. Il convient aussi d'utiliser des formulations équivalentes pour éviter d'induire le public dans l'erreur quant à la renommée d'un artiste dans l'une ou l'autre langue.
Le public, venu au concert pour entendre des interprètes se produire, appréciera que les communications faites au public ne s'éternisent pas et ne dégradent pas la qualité de l'événement par leur amateurisme.
Enfin, les mécènes, commanditaires et politiciens qui se présentent sur scène en groupe pour des raisons promotionnelles ou autres devraient s'abstenir d'imposer au public des séances de bises et d'étreintes.
Accord des instruments
À l'exception des musiciens d'orchestre, qui accordent leurs instruments sur scène après que le hautbois ou le piano ont donné le la, il est préférable de s'occuper de cette tâche en coulisses ou, du moins, de se limiter à une brève retouche. Il peut cependant être souvent nécessaire de réviser l'accord entre deux œuvres ou entre deux mouvements.
Démarche
On doit faire son entrée sur scène avec détermination, mais sans hâte, et éviter de se lancer dans une œuvre sans au moins un moment de silence. Les femmes doivent porter des chaussures permettant une démarche en accord avec l'élégance de leur robe.
Mimiques
Les solistes devraient éviter les poses « romantiques » ou « inspirées », de repousser sans raison leur chevelure par des mouvements brusques de la tête, de taper du pied, de chantonner (à la manière de Glenn Gould), de projeter les mains en l'air à la fin des pièces (ou de faire des mouvements exagérés ou sans proportion avec l'effort fourni). Bref, il faut jouer en respectant le public et non pour « épater la galerie ». Les pianistes devraient garder les deux pieds sur les pédales plutôt que de déplacer sans raison le pied gauche sous le banc.
Transpiration
Les musiciens (en particulier les pianistes) qui ont besoin de s'éponger le front entre les pièces devraient ranger leur mouchoir dans leur poche. Il faut éviter de le déposer sur le cadre du piano, car il est visible depuis les balcons.
Tourneurs de pages
Les tourneurs de page (souvent des étudiants en musique) devraient toujours écouter les œuvres avec la partition avant le concert, s'entendre avec le pianiste au sujet des reprises ou des autres particularités des pièces, feuilleter soigneusement la partition pour s'assurer que des pages n'ont pas tendance à rester collées (et, le cas échéant, en user légèrement les coins au préalable), compter leurs temps dans les passages plus complexes ou en mouvement perpétuel (où le risque de se perdre est plus élevé), se lever quelques mesures avant la fin d'une page et se tenir prêt à tourner au bon moment (pas plus que quelques temps avant la fin de la dernière mesure), et être prêt à réagir si la page tend à revenir sur elle-même.
Lorsque le pianiste quitte la scène, le tourneur de pages doit quitter la scène discrètement en emportant les partitions, tout en conservant une bonne distance, donc sans chercher à s'inclure dans les applaudissements. Le tourneur de pages n'applaudit normalement pas.
Applaudissements
Pour éviter au public d'applaudir à un moment inopportun, les interprètes doivent veiller à limiter l'ampleur de leurs mouvements à la fin des pièces et à faire sentir discrètement que l'œuvre n'est pas terminée.
Poignées de main
À la fin d'un concerto, le soliste serre la main du chef d'orchestre et ensuite du chef d'attaque. Un soliste (chanteur, violoniste, etc.) se tourne d'abord vers son partenaire ou accompagnateur pour le remercier avant de saluer le public. Le soliste se voit offrir un bouquet de fleurs, parfois par un enfant. On peut douter de la pertinence des bises et des étreintes, qui sont devenues omniprésentes.
Saluts
Les solistes doivent prendre le temps nécessaire pour saluer le public. Ils doivent se placer de manière à être vus de face, et ce, dans un endroit où l'éclairage les atteint. L'ampleur du salut est normalement proportionnelle à l'âge, à la renommée et à la qualité de l'exécution. Ainsi, une diva adulée qui vient de chanter un air célèbre d'une façon admirable se penchera souvent vers son public en fléchissant le genou, mais une étudiante s'abstiendra de ce cérémonial et ne s'inclinera que légèrement, par modestie.
Comme de nombreux spectateurs voudront bien voir l'interprète, il faut prendre le temps requis pour saluer, mais sans toutefois exagérer. On ne doit surtout pas être gêné de saluer selon les règles de l'art, donc faire les choses correctement jusqu'au bout.
Rappels (bis)
L'identification d'un rappel (angl. encore) devrait idéalement être annoncée dans la langue du public, et ce, haut et fort, de manière à être bien compris. Pour faciliter la compréhension, il est souhaitable d'attendre quelques instants après avoir signifié son intention de manière à ce que les bruits de salle aient pu s'apaiser. Même si certains rappels sont bien connus, il vaut toujours mieux les identifier, car nombre de spectateurs (probablement la majorité) ne connaîtront pas la pièce et aimeront savoir ce qu'ils entendent. Idéalement, les organismes qui présentent des concerts devraient afficher sur leur site Web et leurs réseaux sociaux la liste des rappels et des changements au programme aussi rapidement que possible après le concert.
Public
Les suggestions contenues dans cette section visent à permettre aux spectateurs de s'intégrer à ces activités assez ritualisées que sont les concerts symphoniques, les récitals et les représentations d'opéra. En tenant compte de ces conventions plus ou moins universelles, on permettra à l'ensemble des spectateurs de profiter au maximum d'un événement sans être dérangés ou choqués par des comportements inappropriés qui ne tiennent pas compte du caractère collectif de l'activité.
Tenue vestimentaire
Le code vestimentaire (angl. dress code) est beaucoup moins rigoureux aujourd'hui que par le passé, tant pour le public que pour les interprètes. On peut d'ailleurs voir tous les types de tenues, du jean aux vêtements de soirée. Une tenue propre et sobre dans laquelle on se sent à l'aise est généralement la façon idéale de se présenter, à moins qu'il ne s'agisse d'un concert gala ou que l'on ne soit invité à une réception après le concert.
Il ne faut pas oublier que les traditions sont plus ancrées dans certains pays que dans d'autres et qu'une tenue négligée pourra au mieux faire froncer les sourcils. Les premières d'opéra sont souvent plus formelles que les autres représentations et que les concerts symphoniques.
Quelle que soit la tenue choisie, il ne faut jamais porter de chapeau, car il s'agit d'une obstruction visuelle désagréable pour les personnes assises derrière soi.
Bijoux et parfums
Il faut renoncer aux bijoux qui font des cliquetis et pourraient ainsi déranger les voisins. Les parfums, eaux de toilette et lotions après-rasage devraient être utilisés avec la plus grande modération. Il est même préférable de s'en abstenir, car ils peuvent incommoder les autres spectateurs, voire provoquer des éternuements.
Arrivée à la salle
Il est important de planifier ses déplacements de manière à arriver sur les lieux d'un concert ou d'un opéra avec suffisamment de temps d'avance. Stationner, laisser ses effets personnels au vestiaire et, au besoin, récupérer ses billets au guichet prend souvent plus de temps que prévu, notamment lorsque des travaux sont en cours à proximité de la salle. Cela laisse aussi quelques minutes pour consulter le programme et se placer dans un état réceptif.
Retardataires
Comme les retardataires dérangent autant le public que les musiciens, les ouvreurs (angl. usher[s], usherette[s]; ital. maschera [pl. maschere]) ne leur permettent habituellement d'entrer qu'à un moment approprié. Pour rendre l'attente moins pénible pour ces personnes, on trouve aujourd'hui dans les foyers de plusieurs salles des moniteurs permettant de suivre le concert depuis l'extérieur. Si l'on reçoit l'autorisation d'entrer avant une pause dans le concert, il est préférable de rester debout contre le mur ou de prendre les premiers sièges libres, si possible, et de ne gagner son siège qu'après l'entracte. Il faut à tout prix éviter de s'excuser à voix haute auprès de chaque personne à qui on frôle les genoux; les gens comprennent que le retardataire fait de son mieux.
Enfants
Il est essentiel de bien préparer les enfants à assister à un concert ou à un opéra en leur présentant les principales règles de conduite.
Appareils électroniques et téléphones
Il est essentiel de désactiver les montres numériques ou téléavertisseurs ainsi que les téléphones portables, y compris les sonneries destinées à rappeler un rendez-vous ou toute forme de notification, avant d'entrer dans la salle. Il faut aussi s'assurer que les appareils auditifs ne produiront pas de bruit gênant. Le problème des sonneries est devenu une plaie dans les salles de concert, comme en témoigne l'épisode survenu pendant l'exécution des dernières pages de la Symphonie no 9 de Mahler lors d'un concert du New York Philharmonic sous la direction d'Alan Gilbert le 10 janvier 2012. Les organismes qui présentent concerts et opéras ne devraient jamais hésiter à rappeler au public l'importance de désactiver tout appareil risquant de déranger le déroulement de l'événement.
Utilisation des réseaux sociaux
Les spectateurs devraient accorder toute leur attention à la représentation et résister à l'envie d'allumer leur téléphone pour afficher leurs commentaires sur les réseaux sociaux. La lumière projetée par l'écran et l'activité au clavier sont incommodantes pour les voisins. Il y a fort à craindre que cette pratique se répande, certaines salles allant même jusqu'à l'encourager en proposant, du moins à titre expérimental, des sièges réservés à cet effet (angl. tweet seats).
Médecins de garde
Les médecins susceptibles de recevoir un appel d'urgence sur leur téléavertisseur devraient voir s'ils peuvent remettre leur appareil au guichet afin que l'on vienne les chercher au besoin. Ils peuvent aussi essayer d'obtenir un siège qui leur permettra de quitter facilement et rapidement les lieux.
Enregistrements
Il est interdit de faire des enregistrements audio ou vidéo de concerts ou d'opéras (et d'en faire la distribution) sans l'autorisation des artistes ou de leurs représentants, et sans accord avec les autorités de la salle où se déroule l'événement. Un concert donné en public n'est pas une activité artistique appartenant au domaine public au sens de la loi sur le droit d'auteur. Les ouvreurs qui verraient une personne en train d'enregistrer pourraient la faire sortir de la salle, ce qui nuirait à la tranquillité des autres spectateurs pendant plusieurs minutes.
Conversations
Le concert n'est pas (ou n'est plus) un lieu où l'on tient des conversations. Par respect pour les spectateurs qui ont payé leur place et s'attendent à profiter au maximum de l'événement, on doit cesser toute conversation dès qu'il devient évident que le concert ou l'opéra s'apprête à commencer (réduction de l'éclairage, entrée d'une personne sur la scène). Les conversations n'intéressent personne dans la salle, peut-être même pas les gens auxquelles elles s'adressent. Il faut aussi éviter de faire des commentaires entre les pièces ou les mouvements, car la musique reprend souvent plus rapidement qu'on ne le pense.
Le prélude ou l'ouverture d'un opéra de même que les interludes font partie intégrante de l'œuvre et ne doivent pas servir à accompagner les restants de conversation. Rien n'est plus désagréable pour qui veut profiter au maximum de la musique que de devoir supporter les commentaires des voisins.
Consommation de nourriture et de bonbons
Manger au concert ou à l'opéra témoigne d'un manque d'éducation flagrant. Certaines salles ont toutefois commencé à permettre la consommation de boissons, ce qui oblige à faire preuve de prudence. Plus particulièrement, les conséquences de la consommation de bonbons et de pastilles, et surtout le dépliage de leurs emballages, est l'un des pires irritants auxquels on peut être soumis dans ce contexte. Une salle de concert est conçue pour diffuser le son, pas pour l'assourdir. Ainsi, tout froissement de papier ou l'ouverture d'une plaquette alvéolée (angl. blister pack) sera entendu à des mètres à la ronde et privera plusieurs auditeurs de la concentration nécessaire pour apprécier l'œuvre.
Si par mégarde un spectateur s'échappe et commence à déplier un emballage, il doit se rappeler qu'un dépliage ou un pliage lent et soigné ne fait que prolonger l'agonie des voisins. Il suffit de le déposer sous son siège plutôt que de le manipuler, et d'attendre l'entracte pour en disposer d'une façon appropriée.
Si l'on doit absolument prendre des pastilles pour la toux, on peut les déballer avant le concert et les placer dans un mouchoir afin d'éviter les problèmes liés aux emballages.
Bruits
Les sources de bruits incommodants sont nombreuses : bracelets et colliers (surtout composés de plusieurs morceaux), boutons-pression, fermetures éclair (particulièrement celles des sacs à main) et velcro, pièces de monnaie et clés, craquements de fauteuils défectueux, ouverture de sacs à main, frottement de tissus synthétiques (comme ceux des vêtements d'hiver), bâillements d'ennui, etc.
Parmi les autres comportements à éviter, on retrouve (outre le dépliage des bonbons) : chantonner, ronfler, taper du pied, battre la mesure sur ses cuisses ou dans les airs (angl. air conducting), mâcher de la gomme bruyamment, croquer des bonbons. Enfin, demander avec force à un spectateur de se taire ou de ne pas faire de bruit (« shhh! ») peut aider à résoudre le problème, mais constitue néanmoins une source de bruit.
Rien n'est plus stressant et désagréable que de se trouver assis à côté ou à proximité de spectateurs qui ne tiennent pas compte de leurs voisins ou affichent un comportement grossier et qui peuvent ainsi gâcher le plaisir de leurs victimes pendant plusieurs minutes en les privant de la concentration requise.
Manipulation de programmes et de livrets
On doit éviter de faire du bruit avec son programme, par exemple en le pliant, roulant ou frottant avec les doigts. Il est facile de le ranger sous le siège (ce qui élimine le risque de l'échapper), surtout si l'éclairage est trop faible ou inexistant pour en permettre la lecture. Les spectateurs assis aux premières rangées des corbeilles, des mezzanines ou des balcons ne doivent jamais déposer leur programme ou tout autre objet sur la balustrade devant eux afin d'éviter que ces objets ne tombent sur les spectateurs assis au parterre. Les ouvreurs veillent généralement à avertir les spectateurs fautifs.
Si un livret contenant les textes des œuvres vocales a été distribué, il est impératif de prendre le plus grand soin en tournant les pages, car le bruit produit par des centaines de programmes manipulés en même temps deviendrait vite intolérable. Il ne faut surtout pas plier le livret dos contre dos, puis comprimer le pli, sous peine d'aggraver le problème. Les organismes devraient d'ailleurs évaluer soigneusement les conséquences d'une telle distribution au public.
Fauteuils bruyants
Les personnes qui ont la malchance d'avoir un siège défectueux ou bruyant ne devraient pas hésiter à signaler le problème au personnel, de préférence à l'entracte ou à la fin du concert, ou à envoyer un mot à la direction de l'organisme ou de la salle. Les problèmes se règlent d'habitude très rapidement, et les spectateurs (y compris le plaignant) en bénéficieront lors des prochains concerts.
Utilisation de jumelles et de lampes de poche
De manière à mieux voir les décors et les personnages à l'opéra, certains spectateurs aiment se servir de jumelles, qu'il est possible de louer dans certaines salles. Il est préférable de ne pas faire de commentaires à son voisin en les lui passant. D'autres personnes se servent d'une lampe de poche ou utilisent le flash de leur téléphone portable pour consulter des détails dans le programme pendant la représentation. Cette pratique devrait être découragée puisqu'elle dérange de nombreux voisins (même à une dizaine de sièges de distance) en attirant leur regard sur la source de lumière.
Maintien
Il est déconseillé de s'appuyer les genoux sur le dossier du siège devant soi ou de donner des coups sur le dossier ou sous le siège. De même, on doit s'abstenir de s'asseoir sur le bout de son siège et de s'appuyer sur le dossier du siège de la rangée précédente ou encore de tirer sur le dossier.
Toux
Dans la mesure du possible, il faut essayer de maîtriser sa toux ou ses éternuements. Si l'on est sujet à tousser, prendre une gorgée de sirop contre la toux avant d'ailler au concert peut aider à régler le problème. Pour amortir le bruit d'un éternuement, il est conseillé d'enfoncer la bouche dans le coude et essayer d'attendre un moment où le volume sonore est particulièrement élevé.
Ovations
Une ovation, souvent appelée ovation debout sous l'influence de l'anglais (angl. standing ovation), devrait être réservée à des exécutions vraiment exceptionnelles méritant beaucoup plus que des applaudissements nourris. Elle ne devrait pas être une pratique presque systématique forçant les autres spectateurs à se lever simplement pour arriver à voir les artistes. Cette pratique, de plus en plus (voir trop) courante, particulièrement en Amérique du Nord, donne aux artistes une idée trompeuse de l'appréciation du public et détourne l'ovation de son sens. Elle ne doit pas souligner que l'artiste n'a guère fait plus que se présenter au moment prévu pour remplir son engagement. Une ovation en cours de concert ou à la fin de la première partie, sauf dans de très rares cas, risque fort d'être considérée comme impertinente.
Applaudissements scandés
Lorsqu'un artiste quitte la scène sans donner de rappel en réponse à des applaudissements nourris, le public peut insister en scandant ses applaudissements (angl. rhythmic clapping, rhythmic applause). Ce type d'applaudissements sert aussi à demander des rappels supplémentaires.
Le sujet a fait l'objet d'un article scientifique : Z. Néda, E. Ravasz, T. Vicsek, Y. Brechet et A. L. Barábasi (Département de physique théorique, Université Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, Roumanie), « Physics of the Rhythmic Applause », Physical Review. E, Statistical Physics, Plasmas, Fluids, and Related Interdisciplinary Topics (American Physical Society, New York) 61, no 6 (juin 2000) : 6786-6792.
Rappels
Le public devrait attendre la fin des rappels pour commencer à préparer son départ (ouverture des sacs à main, pliage et rangement des programmes, déploiement des manteaux, etc.), puis se lever et quitter son siège. Les personnes qui veulent profiter des rappels n'apprécient pas les bruits occasionnés par ces mouvements, pas plus que la présence de personnes debout ici et là dans les allées, voire dans la rangée précédente.
Rien n'empêche le public de continuer à demander des rappels (ou une partie du public d'inciter les autres à le faire), et ce, même après deux ajouts au programme. Il est toujours possible qu'un interprète soit disposé à revenir une autre fois, mais que le public ne semble pas le réclamer, estimant qu'il en a assez donné. C'est à l'interprète à décider quand arrêter.
Départ de la salle
À moins d'une urgence, on ne devrait quitter la salle qu'aux entractes ou à la toute fin du concert. De tels départs, souvent motivés par le désir d'éviter la file d'attente au vestiaire ou au stationnement, sont particulièrement inconvenants à un moment où les artistes cherchent à intensifier l'atmosphère suggérée par l'œuvre. Se lever et quitter la salle avant la fin des rappels peut être vu comme un manque de respect à l'égard des interprètes et des autres auditeurs, et donner aux artistes l'impression que l'on en a assez.
Lorsqu'on assiste à une représentation d'opéra au cinéma, il faut éviter d'empêcher les spectateurs qui le désirent de voir le générique au complet en restant debout devant son siège pendant plusieurs secondes pour récupérer ses effets personnels.
Si l'on n'est pas en mesure d'attendre, il faut veiller à ne pas heurter les têtes des spectateurs de la rangée du bas avec un sac à main ou un manteau. Les personnes qui utilisent des cannes ou des béquilles devraient s'assurer de les avoir rangées parallèlement aux rangées, sous leurs sièges, et non perpendiculairement, afin d'éviter les risques de trébuchement des spectateurs cherchant à sortir.
Applaudissements au concert
Au concert, les applaudissements ont leur place à des moments bien précis :
- lorsque le chef d'attaque (angl. concertmaster [US], leader [GB], all. Konzertmeister), qui arrive sur scène après tous les musiciens, salue le public;
- lorsque le chef d'orchestre fait son entrée;
- lorsque le chef d'orchestre se tourne vers le public avant de commencer le dernier acte d'un opéra.
Les applaudissements doivent être réservés aux moments les plus appropriés (fin d'une sonate, d'un cycle, d'un groupe de pièces ou de mélodies), ce que la disposition des pièces dans le programme permet normalement de déterminer. La présentation des pièces dans le programme donne habituellement une idée des grandes unités dont il est formé. Les mouvements d'une œuvre sont normalement identifiés par leur tempo ou leur titre, et ce, disposés en retrait par rapport au titre principal. En règle générale, les applaudissements sont d'autant plus inopportuns que les pièces sont courtes.
Les interprètes indiquent toujours, par leur gestuelle, si les applaudissements sont les bienvenus, par exemple par un mouvement plus ample des mains ou un déplacement du dos vers l'arrière. Un musicien qui se rapproche de son lutrin indique qu'il doit tourner une page pour poursuivre. De nombreuses œuvres symphoniques se concluent de façon brillante. Cependant, un arrêt de la musique sur un accord joué fortissimo ne signifie donc pas nécessairement qu'une pièce est terminée. Le meilleur exemple est la fin du troisième des quatre mouvements de la Symphonie no 6 (« Pathétique ») de Tchaïkovski.
Contrairement aux spectacles de musique de divertissement, il n'est pas essentiel de marquer sa satisfaction d'entendre l'interprète entamer une pièce favorite. Il reste que l'on entend souvent lors des rappels le plaisir qu'ont bon nombre d'auditeurs à se voir offrir une pièce très connue se superposer à l'annonce ou aux premières notes. Siffler à ce moment est toutefois inconvenant.
Quelle que soit la qualité de l'exécution, il est de mauvais goût de chercher à être le premier à se lever d'un bond et à crier « Bravo! ». Quelques instants de silence partagés avec les musiciens et les autres spectateurs ne peuvent qu'augmenter la satisfaction d'avoir profité d'une expérience musicale de qualité. Il vaut toujours mieux commencer à applaudir quelques secondes après les autres spectateurs qu'avant. On évitera ainsi de gâcher l'effet de la dernière mesure d'Adagio précédant la résolution finale de Messiah de Handel en applaudissant pendant le silence qui suit, alors qu'il reste encore un dernier « Amen » marqué Adagio pour mener à la fin. Exprimer sa satisfaction à ce moment témoignerait non seulement de son statut de néophyte, mais aussi d'une incapacité à percevoir une résolution, puisque la musique est tenue en suspens par un accord de dominante en position de troisième renversement.
Il est habituellement inapproprié d'applaudir l'entrée d'une personne venue faire une annonce au public avant le concert (par exemple un changement au programme) ou faire la promotion d'un abonnement, d'une campagne de financement, etc. Le contexte dictera si des applaudissements sont requis à la sortie de cette personne.
Applaudissements à l'opéra
À l'opéra, il arrive que le public applaudisse un décor que le lever du rideau lui révèle. Ces applaudissements empêchent cependant les auditeurs d'apprécier pleinement la musique. Plus fréquemment encore, le public n'arrive pas à contenir ses applaudissements dès que la partie vocale est terminée, et ce, même s'il reste encore quelques mesures de musique (dont l'intérêt peut être autant majeur que mineur). Lorsque cela se produit, les interprètes ne quittent pas leur rôle (angl. to break character) et restent figés jusqu'à ce que le chef recommence, souvent un peu avant que les applaudissements ne se soient complètement apaisés; en d'autres termes, le chef impose la fin des applaudissements.
Si les manifestations subites d'appréciation peuvent se comprendre dans le cas d'opéras qui sont divisés en numéros ou misent sur la virtuosité ou le divertissement, elles sont hors de question lorsque la musique est continue ou cherche à procurer un plaisir esthétique plus noble. Par principe, il est préférable d'attendre que la musique se soit complètement évanouie avant d'applaudir et ainsi éviter de rompre brusquement l'intensité d'un moment qui, dans les meilleurs cas, devrait pouvoir se graver dans la mémoire. Ces quelques secondes de silence sont aussi utiles pour faciliter le montage lorsque les concerts sont enregistrés.
Lorsque la mise en scène fait en sorte que les personnages sur scène applaudissent l'un d'entre eux qui vient de chanter (on parle alors de musique diégétique), il ne faut pas y avoir un signal pour que le public fasse de même.
Accueil | À
propos du site | Pages essentielles | Bibliographie
Aide | Plan du site | Liste alphabétique des noms de fichiers
Modifications
écentes et nouvelles | Commentaires | Au
sujet de l'auteur
Prix
pour la promotion d'une langue de qualité dans l'enseignement collégial
et universitaire
Gala
des Mérites du français 2003 de l'Office québécois
de la langue française
Le GDRM décline toute responsabilité quant à la validité et à la pérennité des liens Internet fournis
ainsi qu'à l'exactitude et au caractère des données qu'ils renferment.
© Marc-André Roberge 2026
Faculté de musique, Université Laval, Québec