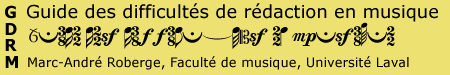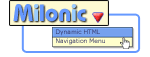- Forme correcte ✓
- Forme fautive ✕
- Exemple ➨
Guides > Disques compacts
La présente page présente les éléments qui doivent ou peuvent être présents pour chacune des parties d'un enregistrement sur disque compact, qu'il s'agisse du disque lui-même, de son emballage ou du contenu du livret qui l'accompagne.
Certaines mentions peuvent également apparaître en d'autres endroits, voire à plusieurs endroits. Il est particulièrement important de fournir avec un enregistrement toutes les informations permettant à l'auditeur de l'apprécier au maximum et au chercheur de trouver les réponses aux questions d'ordre bibliographique ou biographique.
Terminologie français-anglais et dimensions
Les dimensions sont données à titre indicatif seulement, tant en système international qu'en système impérial, et devraient être vérifiées soigneusement avec les fabricants et les imprimeurs de disques compacts, qui proposent généralement sur leurs sites Web des brochures en format PDF ainsi que des gabarits adaptés.
| Français | Anglais | Dimensions (SI) | Dimensions (impérial) |
|---|---|---|---|
| boîtier, boîte, coffret | jewel case | 142,0 mm (largeur) 125,0 mm (hauteur) |
5 18/32 po (largeur) 4 29/32 po (hauteur) |
| disque | record | 120,0 mm (diamètre) | 4 23/32 po (diamètre) |
| étiquette | label | 116,0 mm (diamètre de la partie imprimée, moins une surface circulaire de diamètre variable au centre) | 4 19/32 po (diamètre de la partie imprimée, moins une surface circulaire de diamètre variable au centre) |
| étiquette de dos | spine card | 6,5 mm (largeur) 118,0 mm (hauteur) |
3/8 po (largeur) 4 3/4 po (hauteur) |
| jaquette | inlay card, tray card, jewel case backliner | 138,0 mm (largeur) 118,0 mm (hauteur) |
5 13/32 po (largeur) 4 5/8 po (hauteur) |
| livret | booklet | 121,0 mm (largeur) 120,0 mm (hauteur) 2,0 mm (épaisseur; max. 32 p.) |
4 3/4 po (largeur) 4 23/32 po (hauteur) 3/32 po (épaisseur; max. 32 p.) |
| texte de pochette | liner notes | — | — |
Numéro
Simplicité : Les producteurs auraient avantage à concevoir des préfixes et des numéros non seulement faciles à mémoriser, mais aussi compacts, ce qui peut être très utile aux commerçants et leur éviter des erreurs. Les numéros longs sont d'ailleurs à éviter, car ils doivent être tronqués à quatre positions pour les codes à barres. Un numéro dans lequel l'année de production (ou du moins les deux derniers chiffres) est clairement positionnée peut être utile aux discographes et aux chercheurs.
Disque et étiquette
Division en pistes : Un disque devrait toujours être divisé en pistes (et non en ✕plages) suffisamment nombreuses pour permettre un repérage facile et flexible, et ce, même s'il s'agit d'une œuvre longue sans véritables divisions; le nombre maximum de pistes est de 99. Ainsi, on utilisera une piste pour le thème et chaque variation d'un thème et variations ou pour chque partie d'une fugue double ou triple. Il est préférable d'éviter les numéros secondaires (par exemple 5.1, 5.2), car ils ne peuvent pas être sélectionnés avec la même facilité sur tous les lecteurs; ce type de division a pratiquement disparu.
Identification de la compagnie et du disque : Le nom de la compagnie (étiquette, label) et son logo figurent d'une façon à la fois claire et discrète sur l'étiquette.
Numéros : Le numéro de catalogue du disque et le numéro du disque dans un coffret (par exemple disque 1 de 3) apparaissent sur l'étiquette afin de pouvoir les localiser facilement. De plus, un code d'identification comprenant le numéro du disque peut être gravé au laser autour du centre du disque. Enfin, chacun des coffrets contenus dans un boîtier de carton doit porter, sur le dos et sur la jaquette, un numéro permettant de l'identifier facilement.
Contenu : On inscrit, généralement sous le centre, une version abrégée du contenu du disque et des interprètes.
Réservation des droits : On trouve souvent écrites sur le pourtour du disque les mentions suivantes de réservation des droits.
➨Tous
droits du producteur phonographique et du propriétaire de l'œuvre
enregistrée réservés. Sauf autorisation, la duplication,
la location, le prêt, l'utilisation de ce disque pour exécution
publique et radiodiffusion sont interdits.
➨All
rights of the producer and of the owner of the work reproduced reserved. Unauthorized
copying, hiring, lending, public performance and broadcasting of this record
prohibited.
Nom du pays ou de la compagnie de pressage :
➨Fabriqué au/en par [nom du pays/nom de la compagnie]
Logos : Mention « Compact Disc Digital Audio » et autres logos requis.
Jaquette
Codes et logos
Code à barres : Idéalement, un disque devrait comporter un code à barres permettant la lecture en magasin au moyen d'appareils appropriés. Ce code, appelé EAN-13, est imprimé au dos de la jaquette, généralement du côté droit, dans le coin inférieur ou le coin supérieur. Il est administré en France par GS1 France (autrefois Gencod) et par UCC (Universal Code Council) aux États-Unis et au Canada. Compte tenu des coûts d'obtention d'un numéro de manufacturier, il peut être prohibitif d'utiliser un code à barres pour quelques disques, mais la rentabilité est assurée pour une production substantielle.
Code SPARS : Le code SPARS (Society of Professional Audio Recording Studios), composé de l'un ou l'autre de trois groupes de trois lettres (AAD, ADD, DDD), permet d'identifier les techniques utilisées pour l'enregistrement, le mixage et la gravure (les lettres A et D correspondent respectivement à analog et à digital, soit analogique et numérique). Ce code a été très utile dans les premières années du disque compact, lorsque les opérations d'enregistrement n'étaient pas systématiquement numériques; il conserve cependant son utilité dans le cas des repiquages d'enregistrements complètement ou partiellement analogiques.
Label Code : Le label code est un code de quatre ou cinq chiffres précédé des lettres LC et assigné aux fabricants de disques pour permettre à la Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten mbH (Hamburg), de gérer les droits affectés aux disques joués à la radio. On le trouve principalement sur les étiquettes européennes.
➨Archiv
Produktion (LC0113)
➨Deutsche
Grammophon (LC0173)
➨Hyperion
(LC7533)
➨London
(LC0171)
➨Naxos
(LC09158)
➨Nimbus
(LC5871)
➨Teldec
(LC6019)
Logo « Compact Disc Digital Audio » : Le logo « Compact Disc Digital Audio » permet d'indiquer qu'un enregistrement respecte la norme IEC 908 relative à l'enregistrement numérique des données ou le Philips-Sony Compact Disc Digital Audio System Description (Red Book) ou encore les deux à la fois. Le logo est la propriété intellectuelle de la société Koninklijke Philips Electronics N.V., et son utilisation est régie par des règles relatives aux dimensions, à la forme et à la couleur. On le trouve aussi embossé dans les coins supérieur droit et inférieur gauche (à l'envers) de l'intérieur des boîtiers.
Technique d'enregistrement : Le cas échéant, il est possible le logo ou les mots servant à identifier une technique d'enregistrement particulière ayant servi à l'enregistrement.
Durées
Format : Les durées (angl. playing time; all. Spieldauer), tant pour l'ensemble d'un disque que pour les pistes individuelles, s'expriment en français sous la forme 0:00 ou 00:00 ou encore [0:00] ou [00:00], le tout sans espaces insécables, puisque le deux-points n'est pas utilisé dans son rôle habituel de ponctuation. Les traditions autres que françaises utilisent d'autres formats (0000, 00.00, 00'00). Les séries de durées devraient normalement être placées sur une ligne verticale avec alignement à droite pour faciliter la lecture et le repérage.
Durée totale : Par respect pour l'acheteur éventuel, il est souhaitable d'inscrire la durée totale d'un enregistrement dans un endroit facile à localiser, comme le coin supérieur droit. La durée maximale est en principe de 74 minutes (en pratique trois à quatre minutes de plus dans certains cas). Il est possible de calculer facilement la durée totale d'une série de 10 pièces au moyen du Time Calculator de Gordon Smith, qui donne aussi la moyenne des durées.
Durées individuelles : La liste des titres correspondant à chaque piste ainsi que les durées doivent être disposées de façon à pouvoir être lues rapidement et facilement. La présentation sous forme de liste verticale est toujours la meilleure, tandis que la présentation compacte en lignes horizontales est le souvent difficile à lire. Dans le cas d'œuvres en plusieurs mouvements ou sections, il convient de fournir la durée totale ainsi que les durées individuelles. Si le livret comprend une liste complète, une présentation plus compacte peut être utilisée sur la jaquette pour ne pas donner la liste complète des pièces individuelles. Il est toutefois avantageux de fournir des listes aussi complètes que possible sur la jaquette et dans le livret, pour le bénéfice des personnes qui n'ont que le boîtier ou le livret à portée de main.
Enregistrement
Coordonnées de l'enregistrement : Les données relatives aux lieux et aux dates d'enregistrement, ainsi que l'indication des pistes visées, sont des éléments essentiels pour les auteurs de biographies et de discographies. Ces informations sont d'autant plus importantes qu'un disque peut paraître plusieurs mois ou plus après son enregistrement.
Contexte de l'enregistrement : Un enregistrement effectué en public (live) doit faire l'objet d'une mention à cet effet, incluant le contexte, le lieu et la date. Les expressions utilisées sont :
➨fr. Enregistrement en direct
➨angl. Live recording
➨all. Konzertmitschnitt
➨ital. Registrazione dal vivo
Instruments : Il est souhaitable de fournir des précisions sur les instruments utilisés, surtout dans le cas du piano (marque, numéros de modèle et de série) et des instruments à cordes de prestige. Dans le cas du piano, il est également possible d'indiquer le nom de l'accordeur, parfois appelé technicien de piano (angl. piano technician). S'il s'agit d'un enregistrement de musique ancienne, on donne une liste détaillée des instruments d'époque ou des copies, avec les noms des facteurs et les années de fabrication.
Diapason : Dans le cas d'un enregistrement réalisé avec des instruments accordés selon un diapason autre que le diapason courant, il convient de préciser la fréquence utilisée.
Éléments techniques
Mise en page : Si la partie sur laquelle repose le disque dans le boîtier est opaque, la jaquette est imprimée sur une seule face. Elle peut comporter deux faces si cette partie est transparente; dans ce cas, il faut limiter le contenu au minimum et tenir compte de l'obstacle que constituent les griffes circulaires.
Identification : Le nom de l'étiquette, le numéro d'enregistrement, le titre du disque et, le cas échéant, celui de la collection sont généralement placés près du bord de la jaquette.
Repiquages d'enregistrements historiques : Dans le cas d'un repiquage, on précise l'étiquette et le numéro de catalogue de la première parution, ainsi que l'année de production à un endroit approprié. On peut aussi identifier l'équipement utilisé pour réduire les bruits de fond de l'enregistrement original. Il est important de fournir des informations détaillées sur l'enregistrement d'origine, telles que les numéros de matrices et les lieux et dates d'enregistrement. Il est également souhaitable de préciser clairement les années de naissance et de mort des interprètes.
Copyright : Les disques utilisent une double notice de copyright : l'une pour le disque (lettre P encerclée : ℗), l'autre pour le contenu textuel (lettre C encerclée : ©). Elles se composent du symbole, du nom du détenteur des droits et de l'année; on peut regrouper les deux notices à l'aide de l'esperluette.
➨℗ & © GDRM 2002
Certaines compagnies, probablement sous l'influence des génériques de films, utilisent des chiffres romains pour l'année. Malgré la distance qui nous sépare encore des années exprimées par une longue suite de chiffres, comme MMLXXXVIII (2088), les chiffres arabes restent les plus clairs.
Différence entre années du copyright et de l'enregistrement : Lorsque l'enregistrement a été réalisé plusieurs années avant sa mise en marché, il convient d'en faire mention au dos du boîtier, entre autres, pour ne pas suggérer à l'acheteur qu'il a en main un enregistrement récent.
Langues du livret : Si le livret comprend des notes dans plus d'une langue, on précisera par exemple Notes en français (ou Notice en français ou encore Texte de présentation en français), Notes in English, Mit deutschem Kommentar (Kommentar auf Deutsch, Deutsche Textbeilage), Con testo in italiano.
Indication de premier enregistrement : On peut placer un astérisque ou une puce à la suite des titres faisant l'objet d'un premier enregistrement et ajouter au bas de la jaquette une note du genre * Premier enregistrement [sur CD]. Il va sans dire qu'une recherche approfondie s'impose avant d'affirmer quoi que ce soit.
Éléments musicaux et artistiques
Contenu du disque : Les noms des compositeurs doivent toujours être donnés au complet (c'est-à-dire sans abréger les prénoms), avec années de naissance et de mort. Il est essentiel de préciser les dates pour le bénéfice de l'acheteur qui peut ne pas connaître le compositeur en question et avoir besoin de repères. On peut aussi donner les dates pour les auteurs d'arrangements, parfois moins connus et pour lesquels l'information est souvent moins accessible.
Langue : Lorsqu'une œuvre vocale comme un opéra est chantée dans une langue différente de la langue d'origine, on précise par exemple chanté en français.
Version : Dans le cas d'une œuvre dont il existe plus d'une version, on indique, le cas échéant, le nom sous lequel elle est connue et l'année de sa composition.
Partitions : Si l'information paraît pertinente (musique ancienne, œuvres avec éditeur unique, œuvres peu connues), on peut identifier les éditeurs en faisant référence aux pistes.

Cadences : Dans le cas de concertos, particulièrement de la période classique, on identifiera l'auteur des cadences utilisées.
Illustrations : Pour le bénéfice de l'acheteur en magasin, il est préférable d'identifier l'auteur et le titre de l'illustration utilisée sur la couverture du livret ainsi que sa provenance (avec les années de naissance et de mort et l'année de réalisation); on précisera le cas échéant si seul un détail est reproduit.
Dos
Texte : Le dos du boîtier, qui possède une surface très étroite, sert à identifier brièvement le compositeur ou l'interprète ou encore les deux, ainsi que le titre du disque ou une indication très sommaire de son contenu.
Orientation : L'usage est flottant quant à l'orientation du texte apparaissant sur le dos du boîtier (voir la remarque relative aux dos des livres). La pratique la plus courante consiste à écrire le texte de haut en bas sur le côté gauche, et de bas en haut sur le côté droit, de sorte que les deux inscriptions sont faciles à lire lorsque le disque est placé à plat. L'autre pratique consiste à placer les inscriptions des deux côtés de manière à ce qu'elles puissent être lues de haut en bas lorsque le disque est tenu à la verticale; il n'est pas possible de lire l'inscription du côté droit lorsque le disque est posé à plat, mais on peut lire de haut en bas si le disque est rangé à l'envers sur une tablette.
Livret
Typographie et mise en page
Livret multilingue : Certains éléments d'un livret multilingue, comme les mentions brèves ne formant pas une phrase complète, peuvent être placés les uns à la suite des autres et séparés par une puce ou un point médian. Dans les textes, on respecte les conventions typographiques propres à chacune des langues, y compris les guillemets. Ceci signifie que seul le texte français doit faire appel aux espaces insécables avec certains signes de ponctuation.
➨Notes en français • Notes in English • Kommentar auf Deutsch
Polices : Les polices doivent être facilement lisibles compte tenu du type de papier choisi (souvent glacé). La taille des caractères ainsi que leur graisse doivent aussi permettre une lecture aisée. Même si une taille plus réduite s'impose souvent pour réduire le nombre de pages et par conséquent les coûts, il est important de ne pas négliger les difficultés de lecture auxquelles peut être confrontée une population vieillissante. Il faut enfin éviter les polices dont les associations historiques pourraient jurer avec le contenu de l'enregistrement, par exemple une police d'inspiration Art nouveau comme Böcklin pour un disque de musique ancienne.
Pagination et nombre de pages : Si l'on peut omettre de paginer un feuillet cartonné plié en deux ou en trois, il est en revanche essentiel de le faire pour les pages d'un livret substantiel. La pratique est assez flottante, mais il semble correct de considérer la couverture comme étant la page 1 (non numérotée). Il est aussi possible de commencer la numérotation avec la première page recto, mais il devient alors difficile de faire référence avec précision à la deuxième de couverture.
Nombre maximum de pages : Un livret qui doit être glissé mécaniquement sous les paires de griffes d'un boîtier (tabs) ne peut généralement pas dépasser 32 pages. On peut cependant trouver sur le marché des livrets faisant 56, voire 64 pages; l'épaisseur du papier est évidemment plus réduite que dans les livrets standards.
Numérotation des pistes et indication des durées
Numérotation des pistes : Les chiffres utilisés pour la numérotation des pistes sont normalement composés dans une police sans empattement et encadrés. (On peut se procurer une police appropriée, comme CombiNumerals PRO, qui donne aussi accès à de nombreux symboles et logos utilisés dans l'industrie du disque, de la vidéo et de l'informatique, à The Font Site.) Les pistes doivent être numérotées tant à l'intérieur du livret que sur la jaquette.
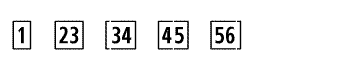
Correspondance entre les numéros des pistes et les divisions d'une œuvre : Dans la mesure du possible, il est conseillé d'établir une correspondance entre les numéros des pistes et les numéros des différentes parties d'une œuvre. Ainsi, on évitera de placer au début d'un disque une pièce qui ferait en sorte qu'une série de 24 préludes porteraient les numéros de pistes 2 à 25 plutôt que 1 à 24.
Exactitude des durées : Les durées inscrites sur la jaquette et dans le livret doivent correspondre aux durées réelles de la version finale de l'enregistrement.
Liste du contenu et des durées : Le livret doit comprendre dès la première page une liste complète, piste par piste, des pièces contenues sur le disque avec leurs durées respectives, à moins qu'elle n'apparaisse au dos du livret, ce qui permet de lire la page sans avoir à retirer le livret du boîtier.
Contenu du livret
Notes biographiques sur les compositeurs et les interprètes : Même si des notes biographiques assez détaillées (avec photos) sont toujours appropriées, il est particulièrement important d'en fournir dans le cas de compositeurs vivants ou peu connus et d'artistes en début de carrière. On peut aussi fournir les références à des sites Web.
Notes sur les œuvres : Les notes d'introduction aux œuvres, qui peuvent être de longueur très variable, devraient idéalement être confiés à un spécialiste du domaine et être signées, avec notice de copyright. Dans le cas d'une série d'enregistrements consacrés à une partie de l'œuvre d'un compositeur (par exemple la musique pour piano), on peut reprendre les notes biographiques d'un livret à l'autre et ajouter les commentaires spécifiques portant sur les pièces contenues dans chacun des disques.
Exemples musicaux : Un livret peut contenir des exemples musicaux si nécessaire. Dans le cas d'un livret en plusieurs langues, pour éviter de multiplier le nombre de pages, on peut ne présenter les exemples que dans le texte dans la langue principale et insérer des références du type [Voir exemple 4, p. 6], de préférence en gras pour leur permettre de bien se détacher.
Traductions : Si le texte est traduit dans une ou plusieurs langues, il faut identifier à chaque fois le traducteur à la suite du nom de l'auteur.
➨© John Grant 2002 (traduction : Louise Dupont)
Tous les textes devraient être présentés aussi dans les autres langues, à moins qu'un texte différent ne soit proposé pour chacune des langues représentées dans le livret. Il faut éviter de reproduire les notes biographiques uniquement dans la langue principale tandis que les textes d'introduction sont traduits.
Éléments de nature promotionnelle : Si la chose apparaît utile, on peut proposer par exemple une liste des prix remportés par les des disques faisant partie de la même collection ou par les autres disques de l'interprète, des extraits de critiques (en mentionnant la source) au sujet des autres disques ou encore une liste d'autres enregistrements du même compositeur.
Personnel technique et équipement : Parmi les membres du personnel technique dont les noms peuvent figurer dans le livret (ou sur la jaquette), on retrouve le producteur, l'ingénieur du son, le monteur, le rédacteur du livret et le graphiste. Certaines compagnies fournissent aussi des données techniques sur l'équipement utilisé pour l'enregistrement (haut-parleurs, microphones, etc.).
Remerciements : Il peut être à propos d'inclure un paragraphe de remerciements, particulièrement si l'enregistrement a fait l'objet d'une subvention ou d'un aide financière quelconque. Les logos des organismes subventionnaires peuvent figurer dans cette section ou, mieux encore, apparaître sur la jaquette du disque.
Lieu d'impression du livret : Imprimé à/au/aux/en [nom du pays].
Musique vocale (particulièrement opéra)
Table des matières : Un livret très élaboré et comprenant par exemple plusieurs articles en plus d'une langue et la reproduction d'un libretto devrait comporter au début une table des matières détaillée avec indication des numéros de pages.
Version complète : Il arrive trop souvent que les enregistrements d'opéras, comme les productions, omettent certains passages. Si cette pratique peut être tolérable dans le cas d'œuvres dont il existe plusieurs enregistrements, elle ne devrait jamais être appliquée lors de la première réalisation d'un opéra, ou encore lors de la première gravure sur disque compact, surtout lorsqu'il s'agit d'une œuvre qui reste de ne pas faire l'objet d'une autre parution avant longtemps. Les chercheurs et les amateurs attendent souvent un tel enregistrement depuis des années, et présenter un enregistrement amputé est un moyen sûr de déplaire à ces personnes, qui sont en fait les principaux acheteurs.
Personnages et interprètes : La liste des personnages suit l'ordre utilisé par le compositeur dans la partition et doit identifier les personnages et préciser les liens qui existent entre eux, comme dans l'exemple ci-dessous, tiré de Die Zauberflöte de Mozart. Il faut aller au-delà des informations fournies dans la partition elle-même. La présentation classique consiste à placer le nom du personnage à gauche et le nom de l'interprète à droite, avec indication du registre de voix.
➨Tamino,
un prince égyptien
Papageno, un oiseleur
Monostatos, un esclave maure du palais de Sarastro
Sarastro, grand prêtre du temple d'Isis; etc.
Contenu détaillé des pistes : Pour chacune des pistes du disque, qui doivent correspondre à une division logique de l'œuvre, on fournit les numéros des pistes de même que les incipit des sections (avec indication des personnages présents), ainsi que la durée et la page de début du passage dans le livret.
Résumé de l'intrigue : Le résumé de l'intrigue, acte par acte, devrait correspondre à l'œuvre telle qu'enregistrée. Autrement dit, un résumé devrait tenir compte des éventuelles coupures qui pourraient être effectuées (ceci dit tout en espérant que le besoin d'offrir une version amputée ne se présentera jamais). On peut insérer aux endroits appropriés les numéros des disques et des pistes pour faciliter la localisation des passages.
Traduction du libretto : Même si plusieurs éditeurs renoncent à offrir le libretto pour éviter d'augmenter le nombre de pages, il est toujours souhaitable de reproduire le texte complet de l'œuvre dans la langue d'origine et dans au moins une autre langue. Si l'œuvre est chantée en traduction, ce qui est assez rare, la langue en question peut être considérée comme suffisante. Dans le cas où l'on reproduit l'original et une seule traduction, on place la première dans la colonne de gauche et la seconde dans la colonne de droite. Si l'original est accompagné de plus d'une traduction, l'original apparaît dans la première colonne des rectos avec traductions de part et d'autre de cette colonne (sur le verso de la page précédente et à droite de la colonne reproduisant le texte original), ce qui permet à une personne polyglotte de comparer les traductions en jetant un coup d'œil à gauche et à droite. On peut aussi placer les textes de présentation dans la colonne non occupée par le libretto et ses traductions dans une typographie contrastante.
Noms des personnages : Les noms des personnages sont composés de manière à se détacher du texte, mais avec discrétion.
Dialogues simultanés : Lorsqu'un passage fait entendre plusieurs personnages simultanément, un long crochet vertical placé légèrement en retrait dans la marge de gauche permet de regrouper l'ensemble du texte visé. Si l'on se sert de WordPerfect, on peut utiliser la macro Brackets.wcm de Barry MacDonnell.
Paroles répétées : Dans le cas d'un texte dont la mise en musique répète les paroles, par exemple la dernière phrase, on utilise le mot etc., composé en italique, à la fin de la phrase répétée.
Références aux pistes : Les numéros des pistes de l'enregistrement, à l'intérieur de leurs carrés (crochets dans l'exemple ci-dessous), peuvent servir à identifier les passages dont il est question dans le texte explicatif. Dans le cas d'un coffret de plusieurs disques, ce qui est souvent le cas pour des opéras, le numéro du disque sert de titre de section à l'intérieur du texte, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de le mentionner. Pour faire un renvoi, on peut l'ajouter avant le numéro de la piste à l'intérieur d'un chiffre encerclé permettant de le différencier.
➨[4] Tannhäuser se retrouve dans une vallée au haut de laquelle on aperçoit le château de la Wartburg. Un berger passe chantant une mélodie pastorale. [5] On entend le chant des pèlerins revenant de Rome.
Didascalies : Les didascalies (indications de jeu et descriptions des décors d'une scène) se composent en italique de façon à se détacher du reste du texte.
Utilisation du romain : Il est préférable de composer toutes les langues en romain et de ne pas utiliser l'italique, souvent considéré comme plus difficile à lire.
Exemples musicaux : Le livret peut, au moyen de numéros, renvoyer à une liste (reproduite ailleurs dans le livret) d'exemples musicaux numérotés, comme les leitmotive d'un opéra de Wagner. Ces numéros devraient alors apparaître à gauche du texte original dans la marge, afin d'attirer l'attention sur leur utilisation à un moment précis.
Accueil | À
propos du site | Pages essentielles | Bibliographie
Aide | Plan du site | Liste alphabétique des noms de fichiers
Modifications
écentes et nouvelles | Commentaires | Au
sujet de l'auteur
Prix
pour la promotion d'une langue de qualité dans l'enseignement collégial
et universitaire
Gala
des Mérites du français 2003 de l'Office québécois
de la langue française
Le GDRM décline toute responsabilité quant à la validité et à la pérennité des liens Internet fournis
ainsi qu'à l'exactitude et au caractère des données qu'ils renferment.
© Marc-André Roberge 2026
Faculté de musique, Université Laval, Québec