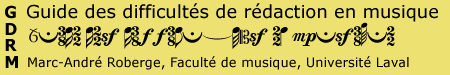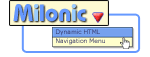- Forme correcte ✓
- Forme fautive ✕
- Exemple ➨
Citations, exemples musicaux, notes, bibliographies, tableaux, etc. > Textes préliminaires ou liminaires, etc.
La présente page fournit les informations de base sur les différentes parties des préliminaires d'un ouvrage, du moins celles qui sont sous la responsabilité de l'auteur; elles sont présentées dans l'ordre où on les retrouve habituellement. Pour un traitement détaillé, voir University of Chicago 2017, chap. 1, p. 4-35, et Malo 1996, passim.
Dos : Le titre d'un livre qui apparaît sur le dos s'écrit de façon transversale ou de façon descendante, autrement dit de haut en bas, comme le prescrit la norme ISO 6357.
Les éditeurs français, allemands et italiens écrivent généralement le titre de bas en haut, alors que la logique (que reflète la norme ISO 6357) recommande de le disposer de haut en bas, comme le font les éditeurs anglophones. D'ailleurs, les livres sont disposés dans les bibliothèques de façon à ce que l'on parcoure les rayons de gauche à droite, et donc que l'on avance la tête penchée vers la droite. Un titre ascendant oblige cependant à pencher la tête vers la gauche pour le lire. On peut imaginer l'étourdissement qui peut en résulter lorsqu'on passe des heures en bibliothèque à incliner la tête tantôt à gauche, tantôt à droite, selon les pratiques utilisées. De plus, il est impossible de lire un titre écrit de bas en haut lorsque que le livre est posé à plat sur une table, son titre se trouvant alors à l'envers.
Enfin, une pratique correspondant à la norme ISO éviterait aux libraires francophones qui vendent des livres en anglais (et des livres québécois qui utilisent la pratique nord-américaine) de les disposer à l'envers pour éviter à leurs clients de pencher la tête tantôt d'un côté, tantôt de l'autre.
Frontispice : Le frontispice (mot masculin; ou page frontispice; angl. frontispiece), qui se trouve en face de la page de titre, sert à présenter une photo ou une illustration, souvent sur un type de papier différent.
Page de titre : Une page de titre (et non ✕page titre ou page-titre) doit comprendre le titre et le sous-titre de l'ouvrage, le nom de l'auteur, le nom de la maison d'édition, le nom de la ville où elle est située et l'année de publication. Dans le cas d'un travail de recherche, on retrouve le nom de l'établissement et de la faculté, le numéro et le titre du cours, le titre et le sous-titre du travail, le nom de l'auteur (précédé de la préposition par), le nom de la personne à qui le texte est remis (présenté à), ainsi que la date (incluant le jour et le mois, si nécessaire). Les pages de titre des mémoires de maîtrise et des thèses de doctorat doivent respecter pour leur part un mode de présentation rigoureux prescrit par les autorités de l'établissement; c'est aussi généralement le cas pour les travaux de recherche.
Notice de copyright : Il est toujours souhaitable, même s'il ne s'agit pas d'une publication commerciale faisant l'objet d'un dépôt légal, d'inclure une notice de copyright. Au Canada, cette notice prend la forme © Nom de l'auteur ou de l'éditeur année. On voit parfois aussi sur une autre ligne Tous droits réservés, qui étend la protection en fonction de la Convention de Buenos Aires à laquelle ont adhéré les pays d'Amérique latine.
Dédicace : La dédicace est une inscription par laquelle l'auteur rend hommage à une ou à plusieurs personnes. Si elle est courante dans les livres, elle a rarement sa place dans les textes de moindre envergure. Elle peut toutefois convenir à un mémoire de maîtrise ou à une thèse de doctorat, mais en aucun cas à un travail de recherche. On omet généralement le point.
➨À toutes les personnes qui croient que la rédaction en musique est une chose simple
Épigraphe : Une épigraphe (mot féminin) est une citation placée en tête d'un livre et permettant d'en résumer son propos. Il convient d'en identifier l'auteur et la source sans toutefois fournir une notice bibliographique complète, quitte à y revenir plus en détail dans l'avant-propos. Les épigraphes sont réservées aux ouvrages d'envergure et ne conviennent pas aux travaux de recherche. De plus, elles ne doivent pas simplement servir à citer un passage d'un auteur favori.
Table des matières : La table des matières consiste en une liste plus ou moins détaillée des titres des chapitres (et des sections qui les composent) et des autres subdivisions d'un ouvrage. En règle générale, les numéros des pages initiales de chacune des sections (et non les intervalles de pages) font l'objet d'une colonne à droite; de plus, le mot page n'a pas à figurer au-dessus de la colonne des numéros.
Selon la tradition française, la table des matières est placée à la fin d'un livre et non près du début, comme c'est le cas dans la tradition anglo-américaine. Bien que celle-ci commence à gagner du terrain dans le monde francophone, il serait préférable de l'adopter de façon systématique, car c'est en ouvrant un ouvrage que l'on veut en connaître le contenu et non en le fermant.
Les titres de chapitres et de sections d'une table des matières, comme ces mêmes titres dans le texte, doivent utiliser les majuscules uniquement lorsqu'elles sont essentielles. En d'autres mots, si l'on a choisi d'utiliser les règles traditionnelles, celles-ci ne s'appliquent qu'aux titres d'œuvres et d'ouvrages, ce que les titres visés ici ne sont pas.
(Liste des) tableaux, illustrations (figures), exemples musicaux, abréviations : On doit fournir autant de listes qu'un ouvrage contient de catégories telles que tableaux, illustrations (aussi appelées figures), exemples musicaux, abréviations (incluant sigles et acronymes). Les mots Liste des peuvent figurer dans la table des matières, mais non dans l'intitulé de la section. Les listes ne doivent contenir que l'essentiel des titres, légendes, etc.
Titres courants : Un ouvrage savant devrait toujours comporter des titres courants permettant d'accéder facilement au contenu en feuilletant les pages. Ces titres sont placés en haut de la page, à quelques espaces du numéro de page, vers le centre de la reliure. Les titres des pages paires se trouvent sur les versos et les titres des pages impaires sur les rectos. Dans une biographie, il peut être utile de se servir de l'année faisant l'objet de la page et de l'âge de la personne à ce moment, comme l'a fait Edward J. Dent dans Ferruccio Busoni : A Biography (Londres : Oxford University Press, 1933).
Lorsqu'il y a plusieurs titres de sections sur un même recto, c'est le dernier titre de la page qui est retenu ; dans le cas d'un verso, c'est le premier.
Préface : Une préface (angl. foreword) est un texte de présentation d'un ouvrage, généralement rédigé par une personnalité prestigieuse dont les propos servent en quelque sorte de recommandation. Selon la tradition française, une préface est composée en italique, une pratique qui aurait tout avantage à être abandonnée compte tenu des difficultés de lecture que posent des textes longs en italique.
Avant-propos : Un avant-propos (angl. preface) est un texte assez concis dans lequel l'auteur présente la genèse de son ouvrage, l'état de la recherche sur la question traitée, ses intentions, la méthode utilisée, les limites et particularités du livre, etc. L'avant-propos peut aussi comprendre des remerciements s'ils ne font pas l'objet d'une section séparée.
En anglais, le foreword (et non ✕forward, faute fréquente) est écrit par une personne autre que l'auteur, et la preface par l'auteur. En français, la préface est signée par une personne autre que l'auteur, tandis que l'avant-propos, qui correspond à ce que l'on appelle en anglais preface, est rédigé par l'auteur.
Remerciements : Les remerciements (GB acknowledgements; US acknowlegments) permettent d'exprimer sa reconnaissance aux personnes qui ont contribué à la réalisation du livre : directeur ou directrice de recherche, bibliothécaires ayant permis l'utilisation de documents d'archives, collègues dont l'aide a été sollicitée, organismes subventionnaires, etc. Lorsqu'ils sont trop longs pour être intégrés à l'avant-propos, ils font l'objet d'une section séparée. Bien que le style puisse être moins strict qu'ailleurs dans l'ouvrage, il convient de ne pas trop s'écarter du ton général.
Chronologie : Une chronologie plus ou moins détaillée des principales étapes de la carrière d'une personne est souvent utile dans un ouvrage biographique ou une édition de lettres. Elle est généralement présentée en deux colonnes : la première pour les dates et la seconde pour les événements. Il peut être souhaitable d'adopter une structure grammaticale identique pour l'ensemble des entrées; on utilise généralement un style télégraphique, par exemple en omettant les sujets.
➨24 octobre 1924 : Quitte la France pour l'Allemagne.
Introduction : L'introduction, qui équivaut souvent à un premier chapitre par son ampleur, sert à présenter le sujet, à énoncer la problématique et à décrire le contenu des parties de l'ouvrage. Sa lecture est essentielle pour bien comprendre le texte qui suit. Elle marque le point où commence la numérotation en chiffres arabes (par opposition aux chiffres romains, utilisés pour les autres parties des pages liminaires), mais il peut arriver qu'elle fasse partie des pages liminaires.
Accueil | À
propos du site | Pages essentielles | Bibliographie
Aide | Plan du site | Liste alphabétique des noms de fichiers
Modifications
écentes et nouvelles | Commentaires | Au
sujet de l'auteur
Prix
pour la promotion d'une langue de qualité dans l'enseignement collégial
et universitaire
Gala
des Mérites du français 2003 de l'Office québécois
de la langue française
Le GDRM décline toute responsabilité quant à la validité et à la pérennité des liens Internet fournis
ainsi qu'à l'exactitude et au caractère des données qu'ils renferment.
© Marc-André Roberge 2026
Faculté de musique, Université Laval, Québec