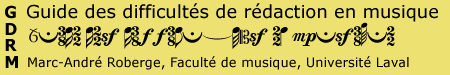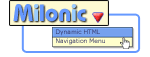- Forme correcte ✓
- Forme fautive ✕
- Exemple ➨
Guides > Surtitres et sous-titres
La présente page fournit des données de base au sujet des surtitres maintenant utilisés de manière courante dans les maisons d'opéra, mais aussi parfois dans lors de récitals de chant. Les remarques s'appliquent aussi en grande partie aux sous-titres tels que l'on peut les trouver à la télévision ou sur un vidéo (mais pas aux sous-titres pour malentendants).
Les problèmes esthétiques liés à la validité des surtitres ainsi qu'à leurs avantages et inconvénients, ainsi que les controverses auxquelles ces questions ont pu donner lieu, ne sont pas abordés ici ; on peut considérer que ce débat est maintenant clos. Il n'est pas davantage question des problèmes qu'implique la traduction du livret d'un opéra compte tenu du contexte de présentation.
Les sources suivantes ont été essentielles à la rédaction de cette page :
- Burton, Jonathan. « The Art and Craft of Opera Surtitling ». Dans Audiovisual Translation : Language Transfer on Screen, sous la direction de Gunilla Andermann et Jorge Díaz-Cintas, 58-69. Londres : Palgrave Macmillan, 2009.
- Dewolf, Linda. « Surtitling Operas, with Examples of Translations from German into French and Dutch ». Dans (Multi)media Translation : Concepts, Practices, and Research, sous la direction d'Yves Gambier et Henrik Gottlieb, 179-188. Amsterdam et Philadelphie : John Benjamins Publishing Company, 2001.
- Karamitroglou, Fotios. « A Proposed Set of Subtitling Standards in Europe ». Translation Journal 2, no 2 (avril 1998).
- Low, Peter. « Surtitles for Opera : A Specialised Translating Task ». Babel (Fédération Internationale des Traducteurs) 48, no 2 (2002) : 97-110.
- Mateo, Marta. « Reception, Text and Context in the Study of Opera Surtitles », dans Doubts and Directions in Translation Studies : Selected Contributions from the EST Congress, Lisbon 2004, sous la direction d'Yves Gambier, Miriam Shlesinger et Radegundis Stolze, 169-182. Amsterdam et Philadelphie : John Benjamins Publishing Company, 2004.
- Pilar, Orero, et Anna Matamala. « Accessible Opera : Overcoming Linguistic and Sensorial Barriers ». Perspectives : Studies in Translatology 15, no 4 (2007): 262-277 (comprend une bibliographie récente).
- Sario, Marjatta, et Susanna Oksanen. « Le sur-titrage des opéras à l'opéra national de Finlande ». Dans Les transferts linguistiques dans les médias audiovisuels, sous la direction d'Yves Gambier, 185-196. Paris : Presses universitaires du Septentrion, 1996.
Bibliographie supplémentaire
The Translator 14, no 2 (2008) : 187-460. DOI. Comprend 10 articles sur des sujets reliés à musique et traduction ainsi que deux bibliographies :
- Franzon, Johan, Marta Mateo, Pilar Orero et Şebnem Susam-Sarajeva. « Translation and Music : A General Bibliography », 453-460. DOI.
- Matamala, Anna, et Pilar Orero. « Opera Translation : An Annotated Bibliography », 427-451. DOI.
Mateo, Marta. « Music and Translation ». Handbook of Translation Studies Online 3 (2012) : 115-121.
La traduction des livrets : Aspects théoriques, historiques et pragmatiques, sous la direction de Gottfried R. Marschall (Paris : Presses de l'Université Paris-Sorbonne, 2004), et plus particulièrement Sylvie Durastanti, « Surtitrer : Enjeux, licences et contraintes », 623-627.
Virkkunen, Riitta. « Aika painaa : Oopperan tekstilaitekäännöksen toiminnalliset rajat [Les limites fonctionnelles des surtitres d'opéra] » (thèse de doctorat, Université de Tampere [Finlande], 2004).
Pour des considérations sur la traduction et le surtitrage, voir un entretien avec Émilie Syssau, traductrice à la Monnaie (Bruxelles), dans Clément Demeure, « Le traducteur : Prima le parole? », Forum Opéra, 28 février 2019.
Pour une présentation grand public des défis de la traduction, voir Heather O'Donovan, « How (and Why) We Translate Operas », WQXR Blog, 21 juin 2019.
Introduction
Définitions : Le mot surtitre (qui s'écrit sans trait d'union) désigne la traduction simultanée des paroles d'un opéra (ou d'un texte chanté ou encore d'une pièce de théâtre) projetée sur un écran placé habituellement au-dessus du cadre de scène (angl. proscenium arch). Le mot sous-titre (qui s'écrit avec un trait d'union) désigne cette même traduction, mais lorsqu'elle est placée au bas d'un écran. Dans le monde de la presse écrite, un surtitre désigne une ligne placée au-dessus du titre proprement dit et qui fournit des informations complémentaires.
Origine : Les surtitres ont été développés à la Canadian Opera Company (Toronto, Ontario) par Gunta Dreifelds, Lotfi Mansouri et John Leberg et ont été utilisés pour la première fois lors d'une production d'Elektra de Richard Strauss donnée le 21 janvier 1983. Ils étaient alors affichés au moyen d'un projecteur à diapositives. Le terme anglais surtitle est une marque de commerce de la Canadian Opera Company utilisé par la conceptrice du système, Gunta Dreifelds, sur son site SURTITLES™.
Terminologie : Le mot surtitre, qui est une adaptation de sous-titre, se dit surtitle en anglais. Aux États-Unis, on voit cependant plus souvent supertitles.
Alternative : Une autre technologie, utilisée depuis 1995 par le Metropolitan Opera sous l'appellation Met Titles, consiste en un écran individuel placé dans le dossier du siège de la rangée précédente. Le spectateur est invité à appuyer sur un bouton au début de chaque acte pour démarrer l'affichage dans l'une des langues proposées. L'écran polarisé, qui peut être éteint, fait en sorte que les voisins ne sont pas dérangés par l'affichage.
Langue du public : Bien que les surtitres soient habituellement utilisés pour traduire d'une langue comme l'allemand ou l'italien (ou du français dans les pays non francophones) vers la langue du public, il est souhaitable, voire essentiel, d'offrir des surtitres pour des opéras chantés dans la langue parlée par la majorité du public afin de rendre les paroles plus compréhensibles.
Surtitres bilingues : Dans le cas de contextes bilingues, les surtitres peuvent être présentés dans les deux langues, en respectant les particularités typographiques de chacune. Si les deux langues doivent être présentées l'une au-dessus de l'autre (plutôt que l'une à côté de l'autre), il faut s'assurer que le rebord d'un balcon ne cachera pas à certaines catégories de spectateurs le haut des lettres, voire une ligne au complet.
Choix de rangée : Il vaut mieux choisir une rangée appropriée pour lire les surtitres sans difficulté, c'est-à-dire habituellement dans la moitié supérieure du parterre. I faut se méfier des modules d'achat en ligne qui ne permettent pas de choisir ses sièges à partir d'un plan de salle mais proposent des places considérées comme les meilleures par un algorithme, car ils peuvent fort bien imposer des rangées situées beaucoup trop à l'avant, surtout lorsque peu de billets ont été vendus.
Travail préalable
Qualités requises : La personne responsable de la réalisation des surtitres doit non seulement avoir une bonne connaissance de l'opéra en général, mais aussi être à l'aise avec les principales langues du domaine (anglais, allemand, italien), et notamment être capable de suivre facilement des dialogues dans la langue de la représentation et de lire une partition. Il est aussi essentiel d'être un traducteur chevronné et de pouvoir collaborer efficacement avec le chef d'orchestre et le metteur en scène, entre autres en assistant aux répétitions. Une familiarité entière avec le logiciel utilisé est enfin essentielle pour éviter les problèmes techniques et réagir rapidement et avec élégance dans les situations difficiles inévitables.
Droit d'auteur : On peut utiliser comme point de départ des surtitres des livrets dans le domaine public, révisés ou non. Il faut cependant obtenir les permissions requises pour utiliser des traductions ou des livrets faisant encore l'objet de droits d'auteur. Quelques compagnies proposent en location sur leurs sites des fichiers contenant leurs traductions (pour la plupart anglaises).
Collaboration : Une collaboration étroite et constante avec le chef d'orchestre et le metteur en scène est essentielle pour prendre en compte les inévitables coupures ou autres changements apportés à la partition.
Partition chant et piano : Le surtitreur doit utiliser idéalement la même partition chant et piano (angl. vocal score) ou, a défaut, la partition d'orchestre (angl. full score) que la production.
Uniformité des noms de personnages : Les surtitres doivent utiliser les mêmes noms que dans le programme pour les personnages. Il faut donc décider si les noms seront traduits ou conserveront la langue d'origine.
Correspondance entre le libretto et la mise en scène : Il faut respecter les particularités de la mise en scène et adapter la traduction aux changements apportés par rapport au libretto, particulièrement dans le cas de mises en scène actualisées. On cherchera donc à remplacer par des équivalents plus génériques les mots décrivant des coiffures, des vêtements ou des accessoires qui seraient loufoques s'ils étaient utilisés dans un contexte où le spectateur verrait autre chose, par exemple « lance ».
Aspects techniques
La présente section ne traite pas des questions relatives à l'équipement utilisé (modèles de projecteurs et puissance, caractéristiques et dimensions de l'écran, etc.) et aux réglages (distance entre le projecteur et l'écran, taille des caractères, etc.). De plus, le GDRM ne saurait fournir une liste des fournisseurs d'équipement et de logiciels; on peut faire une recherche avec les mots clés surtitles software.
Logiciels : Comme le sous-titrage est omniprésent dans le monde de la télévision et de la vidéo, toute une industrie répond aux besoins du domaine. Il existe aussi des logiciels conçus spécifiquement pour la rédaction et la présentation des surtitres; il est aussi possible d'utiliser l'un ou l'autre des logiciels de présentation.
Annotation de la partition : Le surtitreur doit indiquer dans son exemplaire de la partition chant et piano, en utilisant les numéros de diapositives fournis par le logiciel utilisé, les endroits où celles-ci devront être affichées.
Couleur du texte : Les surtitres sont habituellement présentés en blanc (pas trop brillant) sur fond noir.
Alignement du texte : Le texte est normalement centré, bien qu'il semble logique d'aligner à gauche deux lignes courtes chantées par deux personnages, d'autant plus que cela permet de faire entrer un peu plus de texte.
Police : Les polices idéales pour les surtitres sont Arial ou Helvetica, toutes deux sans empattement (angl. sans-serif font), plutôt que des polices à empattements (angl. serif font) comme Times. Bien qu'une police à empattements soit généralement considérée comme mieux adaptée à la lecture d'un texte sur papier, une police sans empattement est nettement préférable pour la lecture de lignes courtes à l'écran, car la graisse plus forte facilite la lecture. La police choisie doit aussi être à espacement proportionnel (ce qui est le cas pour Arial et Helvetica).
Nombre de lignes et de caractères : La plupart des sources suggèrent de se limiter à 2 lignes de 32 à 35 caractères chacune, espaces et ponctuations inclus. Certaines sources suggèrent toutefois une limite de 40 caractères.
Délai entre le début d'une phrase et le surtitre : Il faut laisser un très léger délai (environ un quart de seconde) entre le début d'une phrase et le moment où apparaît le surtitre, plutôt que de les faire apparaître en même temps. Ceci permet au cerveau de mieux traiter l'information.
Durée de l'affichage : Le texte ne doit pas reste affiché trop longtemps afin d'éviter que le spectateur ne soit trop tenté de l'analyser et ne puisse recentrer son attention sur la scène le plus rapidement possible. La phrase peut disparaître environ deux secondes après qu'elle a été chantée. Si un sous-titre doit disparaître rapidement puisque qu'il est directement dans le champ de vision, un surtitre peut pour sa part rester affiché plus longtemps, le spectateur ayant rapidement recentré l'œil sur la scène.
Disparation du texte : Une ligne de texte doit disparaître dès qu'elle n'est plus requise afin d'éviter qu'elle ne demeure inutilement superposée à l'image. Si un sous-titre reste affiché sans raison, il attirera l'attention du spectateur sur un élément qui n'a plus de pertinence. Il doit donc être effacé dès que la voix s'arrête et que la musique prend le relais. On doit donc identifier soigneusement dans la partition les endroits où le texte doit disparaître. Avec un système utilisant des diapositives, il faut alors insérer une diapositive vide.
Apparition du générique : Le générique présenté à la fin des représentations filmées devrait commencer à défiler, par exemple dans le cas d'un opéra, uniquement lorsque tous les solistes ont fait leur entrée individuelle et que le chef d'orchestre est venu les rejoindre. On constate une tendance fréquente à faire apparaître le générique plus ou moins au moment où la grande vedette de la production fait son entrée (tandis que c'est précisément cette personne que le spectateur veut voir sans obstruction visuelle) et que le chef d'orchestre n'est pas encore monté sur la scène.
Applaudissements : Il est souhaitable de fournir sur un enregistrement vidéo toute la période des applaudissements et des ovations de refléter la réalité de l'événement dans son intégralité.
Rédaction des surtitres
Longueur du texte : Il ne faut jamais chercher à convertir le libretto complet en surtitres; ceux-ci ne doivent pas avoir l'aspect d'un texte suivi. La préparation du fichier de projection exige donc un important travail de révision, car plusieurs passages, en particulier dans les ensembles, ne pourront pas être retranscrits à l'écran. C'est aussi le cas pour les longs et très rapides récitatifs des opéras baroques et classiques, qui risqueraient de submerger le spectateur sous un flot de phrases. Il est souvent préférable de condenser, voire de simplifier les propos, afin de ne pas monopoliser trop longtemps l'attention du spectateur. Les coupures peuvent représenter jusqu'à la moitié du texte initial. On peut par exemple omettre les interjections comme ah, ô et oh, dont l'absence n'affectera en rien la compréhension du texte.
Répétitions : Comme la simplicité et la brièveté sont essentielles, les mots ou portions de phrases chantés de nombreuses fois dans des opéras utilisant un style vocal ornementé ne doivent pas être répétés à l'écran. Même si l'on pourrait songer à afficher à nouveau les paroles dans le cas d'un air da capo, il vaut peut-être mieux laisser le public profiter au maximum de la musique.
Apartés : Les apartés (paroles que le spectateur doit comprendre, mais que les autres personnages n'entendent pas) se placent entre parenthèses.
Sauts de lignes et points de suspension : Un énoncé donné doit normalement être présenté sur une seule diapositive sans toutefois afficher à l'avance du texte qui ne sera entendu que plusieurs secondes plus tard. Si une phrase doit être répartie sur deux lignes, il faut couper à un endroit élégant et logique du point de vue grammatical. Ainsi, on ne séparera pas un substantif de l'article qui le précède ou un groupe de mots formant une unité :
✓L'heure bénie où je puis lire / dans le cœur toujours fermé de Lakmé!
✕L'heure bénie où je puis lire dans le / cœur toujours fermé de Lakmé!
Il ne faut jamais permettre qu'une deuxième ligne ne se compose que d'un ou deux mots; seule une disposition équilibrée permettra au spectateur d'absorber facilement le texte.
Lorsqu'il faut répartir le texte sur plus d'une diapositive, on met trois points de suspension directement après le dernier mot de la première portion de la phrase puis directement avant le début de la suite, en ajoutant une espace après les points. L'exemple ci-dessous, qui correspond à quatre diapositives, provient de Carmen de Bizet (acte 3).
La fleur que tu m'avais jetée...
... dans ma prison m'était restée,...
... flétrie et sèche, cette fleur...
... gardait toujours sa douce odeur;...
... et pendant des heures entières,...
... sur mes yeux fermant mes paupières...
... de cette odeur je m'enivrais...
... et dans la nuit je te voyais.
Division de mots : Les mots ne doivent jamais être coupés à la fin des lignes.
Majuscules : Il est préférable de ne jamais utiliser d'éléments entièrement en majuscules puisqu'un texte ainsi écrit est plus long à décoder pour l'œil.
Utilisation des faces : Le gras et le souligné ne s'utilisent pas dans les surtitres. L'italique s'utilise pour une phrase chantée par un personnage que l'on ne voit pas ou pour la lecture d'une lettre ou encore pour un passage chanté dans une autre langue.
Ponctuation : Certains surtitreurs n'utilisent pas de ponctuation à la fin des phrases tandis que d'autres les conservent. La présence des signes de ponctuation semble toutefois nettement préférable. Sauf dans le cas décrit plus haut, il faut cependant éviter les points de suspension inutiles que certains traducteurs ajoutent presque systématiquement à la fin des phrases.
Dialogues et tirets : Un tiret demi-cadratin(–; angl. en dash) ou cadratin (—; angl. em dash) au début de chacune des deux répliques affichées en même temps permet d'identifier la présence de deux personnages; il ne faut en aucun cas utiliser des traits d'union. La présentation des dialogues est délicate, car il faut éviter de présenter en même temps deux phrases dont l'une n'a pas encore été chantée. Il faut garder à l'esprit que le spectateur pourra devoir décoder à qui appartient la phrase du haut, ce qui rend le surtitre moins transparent qu'il ne devrait l'être.
Humour : Il faut éviter de présenter une diapositive de deux lignes dont la seconde contient une phrase de conclusion ayant un but humoristique (angl. punch line), qu'elle soit chantée par le même personnage ou par un autre. Cela évitera que le public ne rie avant que la phrase en question n'ait été chantée.
Ensembles : Le surtitreur devra toujours faire un choix lorsque plus de deux personnes chantent en même temps et donner la priorité aux phrases qui permettent de comprendre le déroulement de l'intrigue. Il peut même devenir préférable de ne pas surtitrer si la polyphonie devient trop complexe.
Contexte particulier aux récitals de chant : Comme la visibilité est souvent très réduite dans les salles de concert, il est difficile pour le public de consulter la liste des œuvres dans le programme (ce qui est une source de distraction pour les voisins, en plus de faire perdre le fil à l'auditeur), on peut envisager de présenter au début de chaque pièce le nom du compositeur (si la chose est essentielle) et le titre de la mélodie. Il est néanmoins essentiel de coordonner cette démarche avec les interprètes avant le concert, de manière à ce qu'ils laissent au surtitreur le temps requis pour afficher l'information. On peut aussi étudier la possibilité d'afficher l'original sur une ligne et la traduction sur l'autre.
Didascalies pour les opéras en version de concert : Lorsqu'un opéra est présenté en version de concert, il peut être pertinent d'ajouter (par exemple entre crochets) de courtes explications adaptées des didascalies au début de longs passages orchestraux ou à certains moments importants où le public pourrait ne pas comprendre ce qui se passe (les chanteurs restant immobiles ou quittant la scène). Par exemple, dans Lohengrin de Wagner, on verrait :
- II/3 : Telramund se cache derrière un pilier de la cathédrale.
- II/4 : Une longue procession de femmes se dirige vers la cathédrale; les nobles se découvrent au passage d'Elsa.
- Fin de l'acte III/2 : Lohengrin tue Telramund; Elsa s'évanouit.
- III/3 : Quatre comtes accompagnés de leurs suites entrent successivement, suivis du roi et des seigneurs saxons.
- Fin de l'acte III : Lohengrin détache la chaîne du cou du cygne, lequel s'enfonce pour laisser place au jeune Gottfried. Ortrud s'effondre et Lohengrin quitte à bord de sa nacelle. Elsa meurt dans les bras de Gottfried.
Signes typographiques : Les principes de base de typographie soignée s'appliquent ici d'autant plus que les écarts par rapport aux meilleures pratiques, comme un guillemet ouvrant ou un deux-points orphelin à la fin d'une ligne, prennent des proportions énormes sur un écran dont la largeur correspond environ aux trois quarts de la scène. Il faut veiller à ce que le texte respecte les éléments suivants :
- espaces insécables avant les deux-points et après les guillemets ouvrants et avant les guillemets fermants;
- accents sur les majuscules;
- véritables guillemets et apostrophes (et non leurs équivalents ASCII);
- une seule espace entre les mots.
Vérification orthographique : Compte tenu de l'affichage d'un nombre limité de mots en gros caractères sur écran, la moindre faute prendra des proportions immenses. Une vérification serrée est donc essentielle et devrait être effectuée par une personne autre que le surtitreur (voire par deux personnes). On peut porter une attention particulière aux homophones grammaticaux, comme a/à, du/dû, la/là, ou/où, que la vérification orthographique pourrait ignorer.
Respect des traditions typographiques : Il faut configurer son logiciel en fonction du contexte linguistique (Canada, France) pour que l'utilisation des espaces insécables respecte les traditions locales. Dans la majorité des cas, il n'est pas possible d'accéder aux espaces insécables fines requises par la tradition française. Au Canada, il est fréquent de ne pas utiliser d'espaces insécables avant les ponctuations hautes (points-virgules, points d'exclamation et d'interrogation) et de les conserver uniquement avec les deux-points et les guillemets français (« ... »).
L'utilisation d'espaces insécables plutôt que des fines avec les ponctuations hautes pose un problème particulier dans les surtitres, en raison de l'ampleur qu'elles prennent à l'écran sur des lignes assez courtes en gros caractères, d'autant plus que les points d'interrogation et d'exclamation abondent dans les librettos. Dans l'exemple plus bas, tiré de la « Chanson bohème » de Carmen de Bizet, l'espace insécable avant le point d'exclamation final occupe tellement d'espace qu'il semble perdre son statut de ponctuation attachée au mot pour devenir un mot en soi.
Plus vive ensuite et plus rapide...
... cela montait, montait, montait !
À moins d'utiliser des logiciels d'éditique, les façons d'insérer des espaces insécables fines dans Word sont loin d'être simples et exigent un travail long et attentif, avec un risque d'erreur élevé.
Si l'on présente des sous-titres dans deux langues, chacune occupant une moitié de l'écran, il faudra respecter la typographie de la deuxième langue (pas d'espaces insécables et guillemets appropriés dans le cas de l'anglais).
Distribution de livrets : Remettre un livret aux spectateurs d'un opéra en version de concert ou d'une œuvre vocale en l'absence de surtitres peut s'avérer une mauvaise idée. Le bruit produit par des centaines de feuilles tournées en même temps, surtout lorsque plusieurs insistent pour plier le livret dos à dos et comprimer le pli ou ensuite le manipuler de diverses façons, produit un bruit désagréable pour l'ensemble de la salle.
Accueil | À
propos du site | Pages essentielles | Bibliographie
Aide | Plan du site | Liste alphabétique des noms de fichiers
Modifications
écentes et nouvelles | Commentaires | Au
sujet de l'auteur
Prix
pour la promotion d'une langue de qualité dans l'enseignement collégial
et universitaire
Gala
des Mérites du français 2003 de l'Office québécois
de la langue française
Le GDRM décline toute responsabilité quant à la validité et à la pérennité des liens Internet fournis
ainsi qu'à l'exactitude et au caractère des données qu'ils renferment.
© Marc-André Roberge 2026
Faculté de musique, Université Laval, Québec