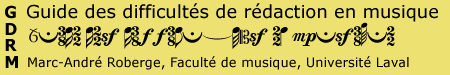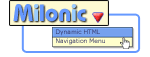- Forme correcte ✓
- Forme fautive ✕
- Exemple ➨
Citations, exemples musicaux, notes, bibliographies, tableaux, etc. > Tableaux
La présente page propose des moyens permettant de faciliter la préparation et la présentation des tableaux, qui sont des grilles composées d'un nombre variable de lignes et de colonnes (au moins deux) servant à présenter une grande quantité de données ayant un lien logique entre elles de manière ordonnée et facilement compréhensible.
Un tableau peut (ou devrait) être utilisé à chaque fois que la compréhension du sujet peut être améliorée ou que la quantité de données et leur complexité exigent une présentation claire et concise pour éviter d'alourdir le texte. Les tableaux sont également un outil précieux pour élaborer une recherche puisqu'ils permettent de donner un sens à une documentation complexe, souvent déroutante au départ, et d'identifier des constantes. Un tableau ne se suffit pas à lui-même et ne doit jamais être « plaqué » sans explications, ce qui revient à laisser les autres faire son travail. Il faut en présenter le contenu et en tirer les conclusions dans le texte.
Il faut éviter d'utiliser un tableau lorsque le contenu des colonnes ne se limite pas à des chiffres ou à des éléments de texte brefs. Si une colonne, souvent la dernière, consiste en explications qui peuvent prendre plus d'une ligne (et à plus forte raison un paragraphe), il est probable qu'il ne s'agisse pas de la présentation la plus appropriée. À plus forte raison, si le contenu d'un tableau peut être présenté en quelques lignes, on doit préférer une présentation dans le texte.
Pour un traitement très détaillé des tableaux, voir le chapitre « Illustrations and Tables » dans le Chicago Manual of Style, 17e éd., 125-70.
Conception
Liste des variables : Dressez la liste des variables à prendre en compte en les plaçant dans l'ordre le plus logique possible.
Nombre de variables : Évitez de consacrer une colonne à une variable qui ne change pas, par exemple le nombre de mouvements d'une série d'œuvres si elles sont toutes en quatre mouvements. Cette donnée devrait être fournie dans le texte ou dans une note.
Colonnes ou lignes : Déterminez s'il est plus logique ou plus avantageux de placer les variables dans les colonnes ou dans des lignes. En règle générale, les variables au nombre restreint sont présentées dans les colonnes et celles pouvant s'étendre à volonté dans les lignes.
Ébauche de grille : Au besoin, préparez sur papier une ébauche de la grille qui contiendra les données en essayant de trouver la solution la plus claire, la plus élégante et la plus efficace. Une planification soignée permettra d'éviter beaucoup de perte de temps.
Explications : Ne laissez jamais un tableau « parler par lui-même » en le « plaquant » entre deux paragraphes. Un tableau sert uniquement à regrouper des données de façon claire, afin d'éviter de les présenter à l'intérieur de phrases complètes. Il faut soi-même l'annoncer, en décrire les grandes lignes et faire la synthèse des données qu'il contient.
Parties du tableau
Référence et numérotation
Référence à un tableau dans le texte : Chaque tableau doit faire l'objet d'une référence directe dans le texte ou entre parenthèses.
➨On
trouvera au tableau 1 une liste des principaux quatuors à cordes
écrits entre 1900 et 1925.
➨Parmi
les quatuors à cordes écrits entre 1900 et 1925 (tableau 1),
[…]
Numérotation : Chaque tableau doit être numéroté de façon consécutive avec un chiffre arabe en commençant avec 1, et ce, sans utiliser l'abréviation no. Dans le cas d'un ouvrage en plusieurs chapitres, on utilise le numéro du chapitre suivi d'un point (et non d'une virgule, puisqu'il ne s'agit pas d'une décimale) et du numéro du tableau à l'intérieur du chapitre. Si le texte ne contient qu'un seul tableau, on omet la numérotation ; le titre suffit puisqu'il est clair de quoi il s'agit.
✓Tableau
1
✓Tableau
4.2
✕Tableau
no 5
Position et alignement : Le numéro et l'intitulé du tableau sont toujours placés avant celui-ci et alignés à gauche ou centrés. Il est recommandé de les composer en gras, peut-être aussi dans la police utilisée pour les titres, afin de faciliter leur repérage. Un tiret cadratin ou un point sépare ces éléments du titre. Le tiret est plus élégant si on adopte la numérotation décimale (par exemple 4.1), puisqu'il permet d'éviter la proximité de deux points. Il n'est pas nécessaire d'ajouter de ponctuation à la fin du titre. Le mot tableau et le numéro qui le suit peuvent être en gras pour mieux les faire ressortir (mais pas la description).
✓Tableau
4.1 — Caractéristiques formelles des sonates pour piano de Franz Schubert
✓Tableau
4. Caractéristiques formelles des sonates piano de Franz Schubert
✕Tableau
4.1. Caractéristiques formelles des sonates de Franz Schubert
Titre
Utilisation de substantifs : Un titre doit être formulé à l'aide de substantifs, donc sans faire appel à un verbe conjugué ou à une proposition relative. Il faut aussi éviter les articles en début de titre.
✓Utilisation
de mélodies folkloriques dans le Sacre du printemps de Stravinsky
✕Les
mélodies folkloriques que Stravinsky a utilisées dans le Sacre du printemps
Concision et neutralité : Un titre de tableau doit être descriptif, concis et neutre, mais sans faire état des détails fournis dans le corps du tableau ou donner une idée des conclusions auxquelles il mène. Ces éléments trouveront leur place dans le texte.
✓Relations tonales dans le troisième mouvement
✕Prédominance des relations de tierces dans le troisième mouvement
Majuscules : Le titre doit utiliser les majuscules uniquement pour le premier mot et ceux qui prennent obligatoirement la majuscule, et ce, même si l'ensemble du document adopte les règles traditionnelles.
Utilisation de filets
Solution simple : Pour du traitement de texte de base, la méthode la plus facile consiste à utiliser la mise en page proposée par le logiciel, à savoir une grille avec un filet simple autour et à l'intérieur du tableau. Les réglages par défaut sont souvent loin d'être optimaux pour une typographie raffinée. Évitez les filets doubles à l'extérieur (et encore plus à l'intérieur), car ils alourdissent inutilement la présentation sans apporter le moindre avantage.
Présentation raffinée : Pour une présentation conforme aux pratiques des meilleurs éditeurs, simplifiez l'apparence du tableau en ne conservant qu'une ligne au-dessus et au-dessous des têtes des colonnes ainsi qu'au-dessous du tableau. L'alignement des données est généralement suffisant pour permettre une lecture facile. Les logiciels de traitement de texte permettent d'appliquer ce format (qui n'est pas utilisé dans les exemples ci-dessous).
Têtes de colonnes et de lignes
Taille des caractères : Dans la mesure du possible, utilisez la même taille pour les têtes de colonnes et de lignes que pour le corps du tableau. Dans le cas de séries de colonnes très étroites contenant des chiffres, il peut être nécessaire de placer les titres à la verticale, de bas en haut, de façon à pouvoir les lire en tournant la feuille d'un quart de tour vers la droite.
Attributs et centrage : Composez les têtes des colonnes en italique (plutôt qu'en gras, qui est l'option par défaut dans le langage HTML). Centrez-les horizontalement et, si les têtes font plus d'une ligne, centrez-les verticalement à l'intérieur de la cellule. Le centrage permet de créer un contraste entre les têtes et le contenu des colonnes qui, lui, est le plus souvent aligné à gauche. Cette disposition permet non seulement de mieux « englober » la colonne, mais aussi d'éviter de confondre une tête de colonne avec le contenu de la rangée qui la suit.
Note : Le GDRM utilise une présentation légèrement différente et mieux adaptée à une page Web dans les pages autres que celle-ci.
Unité syntaxique : Les mots ou groupes de mots utilisés dans les têtes de colonnes doivent tous appartenir à la même catégorie grammaticale ou lexicale.
✓Salles
de concert, Maisons d'opéra
✕Concerts,
Maisons d'opéra
Cellules vides et valeurs nulles
Utilisez un tiret cadratin (—) si aucun élément n'est requis pour une cellule donnée afin d'éviter de suggérer un oubli, et le chiffre zéro (0) si une quantité est nulle.
Alignement des données
Texte, dates et nombres ne faisant pas l'objet de calculs : Le contenu d'un tableau devrait être aligné à gauche et non centré, ce qui contribuerait à créer un flou visuel et à produire une apparence molle et peu dynamique. Le texte doit en outre être non justifié, car cela provoquerait un espacement inélégant, voire exagéré, des mots à l'intérieur des colonnes, surtout les plus étroites.
Nombres pouvant faire l'objet de calculs : Les colonnes contenant des nombres faisant ou pouvant faire l'objet d'une opération mathématique (addition, pourcentage, moyenne) doivent être alignés à droite sur le point ou la virgule décimale.
Indication du nombre d'éléments : La colonne contenant le nombre d'éléments est appelée ✓N et non ✕No, qui est l'abréviation de numéro.
Notes
Notes non numérotées et numérotées : Les notes non numérotées s'appliquent à l'ensemble du tableau et sont identifiées par les mentions Source : ou Note :. Une note indiquant la source des données doit précéder une note apportant des explications. Une note explicative peut faire état de la façon dont les données ont été recueillies ou indiquer qu'un total ne donne pas 100 à cause de l'arrondissement. Les notes numérotées, quant à elles, s'appliquent à une partie du tableau, par exemple pour expliquer une particularité ou un problème relatif à une donnée précise.
Position et numérotation : Les notes d'un tableau sont indépendantes des notes du texte. Elles se placent directement en bas du tableau et non en bas de page. Elles sont identifiées par des lettres minuscules en exposant afin d'éviter toute confusion avec les données numériques du tableau. Il est préférable d'appeler une note dans la partie d'identification (numéro et intitulé du tableau).
Taille : Les notes sont composées dans un corps plus petit. Si le tableau est composé dans un corps plus petit que le texte principal, utilisez le même rapport que celui retrouvé entre le texte et les notes, par exemple 80 % de la police utilisée.
Position et dimensions
Lien avec la première référence : Un tableau devrait apparaître au premier endroit logique après la première référence qui y est faite, habituellement à la suite du paragraphe qui la contient. Il n'est pas souhaitable d'insérer un tableau à l'intérieur d'un paragraphe.
Lignes d'espace : Laissez deux lignes blanches avant et après le tableau.
Marges : Un tableau peut avoir des marges plus étroites que le texte s'il est centré, mais ne doit jamais dépasser les marges de la page. Cette exigence oblige à bien planifier un tableau pour que toutes les colonnes puissent s'insérer avec souplesse à l'intérieur des marges.
Données abondantes et orientation : Utilisez au besoin le format paysage pour la présentation de tableaux comprenant beaucoup de données et exigeant plus d'espace sur la page. Dans ce cas, le haut du tableau doit toujours être placé près de la reliure pour qu'il soit visible en tournant la page d'un quart de tour vers la droite; il n'y a alors aucun autre texte sur cette page. Le numéro de page devrait idéalement apparaître au même endroit que sur les autres pages.
Une autre solution, loin d'être idéale, consiste à réduire la taille de la police, car un mélange de tailles à l'intérieur d'un même texte produira un mauvais effet. En Amérique du Nord, on peut utiliser du papier grand format (8½ × 14 po; angl. legal paper) et plier la feuille en prenant les précautions requises pour que les agrafes ou la reliure ne fassent pas obstacle au dépliage. Cette technique rend toutefois la reproduction plus complexe et ne devrait être utilisée qu'en cas d'absolue nécessité.
Concevoir un tableau bien fait consiste à trouver la façon de présenter les données sans avoir à recourir à des solutions particulières pour quelques-uns des tableaux d'un même document. L'uniformité est toujours préférable. Parvenir à une solution idéale est souvent loin d'être facile.
Nombre réduit de colonnes : Il est possible de n'assigner aux colonnes que la largeur suffisante pour présenter les données clairement et de centrer le tableau. Dans ce cas, le bloc contenant l'intitulé (par exemple Tableau 1 — Relations tonales dans le troisième mouvement) devrait posséder la même largeur que le tableau. Comme cette présentation peut être plus difficile à réaliser, il est souvent préférable de disposer le tableau de façon à ce qu'il occupe la largeur de la page. Il ne sera alors pas nécessaire de le modifier si l'on doit y ajouter d'autres données.
Tableaux longs : si un tableau se poursuit sur une ou plusieurs pages supplémentaires, les têtes de colonnes, appelées lignes d'en-tête dans Microsoft Word, doivent être répétées. Les logiciels de traitement de texte permettent de répéter automatiquement une ou plusieurs lignes en haut de chaque page (angl. header rows). Faites ce réglage de façon systématique pour tous les tableaux afin que la mise en page s'ajuste automatiquement dès qu'un tableau empiète sur une deuxième page.
Langue
Qualité de la langue : La qualité de la langue et la clarté des énoncés sont des éléments aussi importants dans un tableau que dans le texte. Apportez le soin nécessaire à l'uniformité de la présentation et de l'expression. La présentation schématique sous forme de tableau ne doit pas encourager les raccourcis linguistiques.
Majuscules : Limitez l'utilisation des majuscules aux cas où la langue l'exige.
Abréviations : Utilisez les abréviations le moins possible; le cas échéant, assurez-vous qu'elles correspondent aux règles. Servez-vous des mêmes abréviations tout au long d'un tableau et dans tous les tableaux d'un même texte.
Ponctuation : Ne mettez aucune ponctuation à la fin des éléments de contenu à moins qu'il ne s'agisse de phrases complètes. Deux éléments distincts séparés par une ponctuation interne comme un point-virgule ou un point justifient toutefois une ponctuation finale.
➨Cadence de 48 mesures {absence de ponctuation}
➨Voyage de trois mois en Angleterre, suivi d'un bref séjour en France {absence de ponctuation}
➨Modulation à la dominante; section confiée aux cuivres. {ponctuation}
➨Les trois mouvements se suivent sans interruption. {ponctuation}
Dans le cas de mentions d'œuvres suivies de numéros d'opus ou de catalogue et de dates, la ponctuation finale n'est pas nécessaire si on ne trouve que des virgules séparant diverses mentions d'identification essentielles. Elle est alors nécessaire si d'autres ponctuations sont présentes, par exemple un deux-points précédant un numéro de mouvement ou le titre d'un extrait. Dans le cas le plus simple, la présence d'une ou de plusieurs virgules et de parenthèses n'empêche pas de percevoir l'ensemble comme une seule unité.
➨Franz Liszt, Eine Faust-Symphonie in drei Charakterbildern, S. 108 (1854-1857, 1861) {absence de ponctuation}
➨Franz Liszt, Eine Faust-Symphonie in drei Charakterbildern, S. 108 (1854-1857, 1861) : 2e mouvement. {ponctuation}
Uniformité stylistique : Comme pour les têtes de colonnes et de lignes, les formulations utilisées pour les données doivent appartenir à la même catégorie syntaxique. Il faut donner l'impression que chaque entrée a fait l'objet d'une réflexion à ce sujet en trouvant une formulation convenant à toutes les mentions, par exemple en commençant toutes les phrases d'une colonne par un verbe ou un substantif.
Typographie
Simplicité visuelle : Un tableau doit attirer l'attention sur le contenu plutôt que sur la typographie. Évitez donc les raffinements typographiques et graphiques qui ne contribuent pas à la compréhension des données, ce qu'on appelle bruit graphique (angl. chartjunk; terme créé par Edward Tufte dans The Visual Display of Quantative Information [1983]).
Utilisation de couleurs : N'utilisez jamais de couleurs ou de fonds ombragés ou hachurés pour attirer l'attention sur un élément, car ceux-ci ne peuvent pas être reproduits sans dégradation lorsqu'ils sont photocopiés.
Attributs : Sauf raison particulière, évitez d'utiliser le soulignage, qui a maintenant une signification précise, celle d'identifier les liens Internet. Servez-vous du gras, mais avec parcimonie. L'italique peut servir à mettre en valeur certaines données, à condition d'en expliquer l'utilisation dans une note.
Exemples
Les trois exemples suivants, qui utilisent une présentation de base sous forme de grille plutôt qu'une présentation typographique de qualité, illustrent autant de degrés de complexité croissante.
Tableau 1 — Longueur et proportion en pourcentage des parties du « Pezzo giocoso » (2e mouvement) du Concerto pour piano, orchestre et chœur d'hommes, BV 247, de Ferruccio Busoni
| Division | Mesures | N | % |
| Introduction | 1-27 | 27 | 8,0 |
| Partie principale | 28-133 | 106 | 31,5 |
| Partie centrale | 134-185 | 52 | 15,5 |
| Cadence | 186-203 | 18 | 5,4 |
| Retransition | 204-222 | 19 | 5,7 |
| Reprise | 223-301 | 79 | 23,5 |
| Coda | 302-336 | 35 | 10,4 |
| Total | 336 | 100,0 |
Source : Marc-André Roberge, « Le Concerto pour piano, orchestre et chœur d'hommes, op. 39 (1904), de Ferruccio Busoni : étude historique et analytique » (mémoire de maîtrise, McGill University, 1981), 92 (tableau 8.1).
Tableau 2 — Auditions obligatoires pour le cours MUS-19661 — Histoire de la musique IV [abrégé]
| Titre | Disque | Partition |
| Contrôle no 1 | ||
| Arnold Schönberg, Verklärte Nacht, op. 4 | 11401CD | M 1.1 S365 op. 4 I61 |
| Béla Bartók, Concerto pour piano et orchestre no 3, Sz. 119 | 10267CD | M 1.1 B292 C744 no3 B724 |
| Contrôle no 2 | ||
| Dmitri Chostakovitch, Symphonie no 5 en ré mineur, op. 47 | 12085CD | M 1001 S716 op. 47 K14 |
| Charles Ives, Sonate pour piano no 2 (« Concord, Mass., 1840-1860 ») : au moins les 1er et 2e mouvements | 10207-378CD | M 23 I95 no 2 A849 |
| Contrôle no 3 | ||
| Pierre Boulez, Le marteau sans maître | 11259CD | M 1613.3 B763 M375 U58 |
| John Adams, Harmonielehre : au moins la 3e partie (« Meister Eckhardt and Quackie ») | 10398CD | M 1045 A214 H288 A849 |
Note : Les données des colonnes « CD » et « Partition » font référence à la collection de la Bibliothèque générale de l'Université Laval.
Tableau 3 — Évaluation des cours à la Faculté de musique de l'Université Laval (jusqu'en 2002-2003)
| Échelons | Pourcentage | Évaluation du rendement | ||
| Lettre | Moyenne cumulative |
Premier cycle | Deuxième et troisième cycles |
|
| A+ A A- |
4,3 4,0 3,7 |
97-100 % 93-96 % 90-92% |
Excellent (le rendement dépasse de beaucoup le niveau exigé | |
| B+ B B- |
3,3 3,0 2,7 |
87-89 % 83-86 % 80-82 % |
Très bon (le rendement dépasse le niveau satisfaisant) | |
| C+ C |
2,3 2,0 |
77-79 % 73-76 % |
Bon (le rendement est satisfaisant) | Bon (le rendement est satisfaisant) |
| C- | 1,7 | 70-72 % | Insuffisant — échec (le rendement est insuffisant) | |
| D+ D |
1,3 1,0 |
66-69 % 60-65 % |
Passable (le rendement comporte des insuffisances notables | |
| E | 0,0 | 1-59 % | Insuffisant — échec (le rendement est nettement insuffisant) | |
| W | — | 0 % | Échec pour abandon | |
Liste de vérification
Il est essentiel de toujours réviser un tableau afin de s'assurer une présentation impeccable, gage de rigueur. On pourra porter une attention particulière aux éléments suivants.
Accueil | À
propos du site | Pages essentielles | Bibliographie
Aide | Plan du site | Liste alphabétique des noms de fichiers
Modifications
écentes et nouvelles | Commentaires | Au
sujet de l'auteur
Prix
pour la promotion d'une langue de qualité dans l'enseignement collégial
et universitaire
Gala
des Mérites du français 2003 de l'Office québécois
de la langue française
Le GDRM décline toute responsabilité quant à la validité et à la pérennité des liens Internet fournis
ainsi qu'à l'exactitude et au caractère des données qu'ils renferment.
© Marc-André Roberge 2026
Faculté de musique, Université Laval, Québec