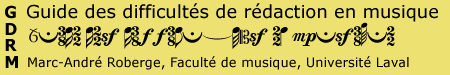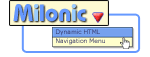- Forme correcte ✓
- Forme fautive ✕
- Exemple ➨
Citations, exemples musicaux, notes, bibliographies, tableaux, etc. > Citations
La présente page présente des techniques permettant de citer dans un texte des passages tirés d'autres sources selon les règles. Elle met aussi en garde contre certaines erreurs fréquentes.
Remarques préliminaires
Rôle des citations : Les citations servent à donner de la crédibilité à ses propos en s'appuyant sur des autorités dans le domaine ou encore à renforcer un énoncé en utilisant une formulation plus brillante ou plus imagée que ce que l'on pourrait écrire soi-même. (On ne doit cependant pas oublier que la façon de dire les choses peut avoir plus de poids que les idées elles-mêmes devant un tribunal chargé d'évaluer le respect des droits d'auteur dans un litige.) Les citations servent également à rapporter les propos exacts d'une personne pour étayer un argument.
Exposition de faits et citations : Lorsqu'une citation se limite à rapporter des faits connus dont on a appris l'existence dans une source, il faut normalement les relater dans ses propres mots (autrement dit paraphraser). Une note est toutefois requise, en particulier lorsqu'il s'agit de transmettre des informations spécialisées, donc que l'on est peu susceptible d'avoir trouvé soi-même. Elle est habituellement superflue s'il s'agit de faits de notoriété publique ou de connaissances communes (angl. common knowledge).
✓Liszt
a été l'un des premiers compositeurs de musique pour piano à
faire appel à l'écriture sur plus de deux portées[appel de note].
✕Dupont
explique que « Liszt a été
l'un des premiers compositeurs de musique pour piano à écrire
sur plus de deux portées »[appel de note].
Dans l'exemple ci-dessus, il serait utile de citer en note un ouvrage comportant une section traitant de l'utilisation de systèmes de plus de deux portées dans la musique de Liszt ou dans la musique pour piano romantique en général.
Justification d'une citation : Il ne suffit pas d'utiliser des guillemets ou d'insérer un appel de note et de citer un ouvrage pour que la présence d'une citation soit justifiée. Le texte qui la précède doit montrer que l'on s'appuie sur les idées d'une autre personne. Adopter une autre approche suggère que l'on s'en remet à une autre personne pour rédiger une ou plusieurs phrases de son texte. En d'autres mots, il faut éviter de « plaquer » une citation dans le texte.
✓On
peut avoir l'impression que la France du début du XXe siècle
n'accordait guère d'importance à Busoni. Comme le souligne Roberge
dans son article sur Busoni et la France, il avait plusieurs amis qui lui
témoignaient un immense respect[appel de note]. L'un de ses grands amis était
le pédagogue Isidor Philipp.
✕On
peut avoir l'impression que la France du début du XXe siècle
n'accordait guère d'importance à Busoni. « Bien au
contraire, Busoni avait plusieurs amis qui lui témoignaient un immense
respect [note]. » L'un de ses grands amis était le pédagogue
Isidor Philipp.
Il faut cependant éviter de multiplier les mentions du genre « dans son livre » ou « dans son article »; le contexte doit normalement être claire en lisant les notes. La mention doit être accompagnée de mots signifiants qui fournissent des éléments permettant de comprendre le contexte de publication. Il faut donc insister sur les propos, et non sur le média, à moins d'avoir une raison de le faire.
On n'a généralement pas besoin de préciser dans le texte de quelle partie d'un ouvrage proviennent les propos. S'il est souvent approprié d'indiquer qu'ils proviennent de l'avant-propos plutôt que du corps du livre, par exemple lorsqu'il s'agit de principes importants dans la conception de l'ouvrage, on n'a pas habituellement pas besoin de savoir qu'il s'agit d'une référence à un chapitre en particulier.
✓Tremblay consacre plusieurs paragraphes à une présentation des positions des deux polémistes[appel de note].
✕Tremblay consacre plusieurs paragraphes du chapitre 5 de son livre à une présentation des positions des deux polémistes[appel de note].
Références à la source : Toute citation, qu'elle soit insérée dans le texte ou placée en retrait, doit faire l'objet d'une référence complète dans une note. Il est essentiel de préciser la ou les pages pour ne pas forcer le lecteur à chercher le passage cité dans la source. De plus, la position par rapport aux guillemets est régie par certaines règles.
Références aux pages dans le texte : Si l'on cite à répétition les pages d'un même ouvrage dans une recension, on place les références aux pages entre parenthèses dans le corps du texte (l'abréviation p. n'est pas essentielle). Elles sont placées avant la ponctuation et, le cas échéant, après le guillemet fermant. Autrement dit, un passage cité directement et suivi d'une référence à la page ne comprend pas de ponctuation avant le guillemet fermant.
➨On
pourra avoir beaucoup de difficulté à suivre l'auteur lorsqu'il
affirme que Henri Herz possède une importance comparable à celle
de Liszt dans la musique pour piano romantique (p. 345) {ou simplement 345}.
➨On
pourra avoir beaucoup de difficulté à suivre l'auteur lorsqu'il
affirme que Henri Herz « possède une importance comparable
à celle de Liszt dans la musique pour piano romantique »
(p. 345).
La ponctuation doit donc se trouver après la parenthèse fermante (et non avant la parenthèse ouvrante). Il faut éviter de commencer une nouvelle phrase après une parenthèse non suivie d'une ponctuation, car le rattachement de la référence pourrait ne pas être clair.
✓L'auteur
a écrit ce livre « en hommage affectueux à sa
charmante bienfaitrice » (p. iii). Il en parle d'ailleurs à
plusieurs reprises dans le premier chapitre.
✕L'auteur
a écrit ce livre « en hommage affectueux à sa
charmante bienfaitrice ». (p. iii) Il en parle d'ailleurs à
plusieurs reprises dans le premier chapitre.
Pour une citation longue (en retrait) lorsqu'on utilise le système auteur-date, la référence se place après la ponctuation finale de la citation, et n'est pas suivie d'un point. L'exemple suivant provient de A. Hannedouche, « Bizet », dans Les musiciens et compositeurs français, précédés d'un essai sur l'histoire de la musique en France avant le XVIIe siècle (Paris : Lecène, Oudin et Cie, Éditeur, 1892), 236.
➨ J'ose dire qu'elle mérite surtout notre admiration et notre reconnaissance parce qu'elle donne à l'art plus d'éclat et de solidité. Victor Massé était très savant, mais il ne faisait pas de musique scientifique. Il se servait de sa science sans la montrer. Il pensait, l'humanité a toujours pensé et elle pensera toujours que le véritable musicien est celui qui chante. (Hannedouche 1892, 236)
Citations problématiques : Il faut s'abstenir de fournir des citations de faible valeur ou qui pourraient mettre en cause la validité de la recherche, et il faut rester vigilant pour les détecter, en particulier lorsqu'on est chargé de l'évaluation d'un texte soumis pour publication. On pense notamment à des citations qui ne contribuent en rien à la discussion (« inutiles »), qui font référence à des sources inexistantes ou peu fiables comme les revues prédatrices (« fantômes »), qui visent à s'attirer des faveurs d'un évaluateur (« de complaisance ») ou qui constituent des références sans objet à ses propres publications (autocitations) afin de gonfler les facteurs d'impact ou les indicateurs bibliométriques.
Citation longue
Contenu et longueur : Un passage cité faisant plus qu'un certain nombre de lignes est généralement placé en retrait ; certains auteurs disent plus de trois lignes, d'autres cinq. Le retrait se fait habituellement des deux côtés, mais parfois aussi à gauche seulement, dans une taille plus petite (et à simple interligne si le texte est à double interligne); une ligne blanche est alors laissée de part et d'autre de la citation.
Guillemets et italique : Plusieurs éditeurs utilisent des guillemets ainsi que l'italique pour l'ensemble de la citation. Cela n'est pas nécessaire puisque la disposition suffit à identifier le type de passage.
Position de l'appel de note : L'appel de note se place à la fin du passage cité, qu'il fasse partie de la phrase ou qu'il soit placé en retrait, et non à la fin de la phrase qui l'introduit. Cette phrase peut, ou non, se terminer par un deux-points; c'est le contexte qui dicte la meilleure solution.
Renfoncement : On insère un renfoncement (tabulation initiale) si la citation correspond à un début de paragraphe dans la source, alors qu'on commence à la marge ou à la position du retrait dans le cas contraire.
Citation courte
Contenu et longueur : Une citation courte peut se composer d'une expression, d'une proposition ou encore d'une ou de plusieurs phrases complètes. Elle aussi peut comprendre la fin d'une phrase et la phrase qui la suit. Contrairement à la citation longue, qui est placée en retrait, la citation courte est insérée directement dans le corps d'un paragraphe, et ce, entre guillemets.
Avantages : Une citation courte incite à continuer la lecture plutôt que d'offrir la possibilité de sauter le passage, comme pour une citation plus longue et placée en retrait. Elle permet de réduire le passage cité au minimum, ce qui accroît l'originalité du texte et diminue les risques inhérents à l'utilisation du travail d'autrui.
Utilisation des guillemets et de la ponctuation : Une citation courte est placée entre guillemets à l'intérieur d'une phrase s'il s'agit d'une expression ou d'une proposition. Elle est précédée d'un deux-points s'il s'agit d'une phrase complète commençant par une majuscule. Dans le premier cas, la ponctuation suit le guillemet fermant; dans le second, elle le précède. Le premier exemple montre aussi l'utilisation de crochets pour marquer un changement d'orthographe par rapport à la source afin de l'adapter à la structure de phrase du texte. On devrait essayer de réduire ce type de changement au minimum.
➨Il
venait de lui annoncer qu'il avait décidé de « recommence[r]
l'étude du piano depuis le tout début ».
➨Il
venait de lui annoncer sa décision en ces termes : « Je recommence
l'étude du piano depuis le tout début. »
Phrase d'introduction : La phrase qui amène une courte citation introduite par un deux-points devrait idéalement dépasser quelques mots.
✓Dans
ses mémoires publiées en 1928, le compositeur écrivait :
« Je n'ai jamais eu à travailler pour arriver à écrire ces
pages complexes. »
✕Le
compositeur écrivait : « Je n'ai jamais eu à travailler
pour arriver à écrire ces pages complexes. »
Cependant, on ne peut pas élaborer une citation introduite par quelques mots suivis d'un deux-points à l'intérieur de la même phrase. Il faut en commencer une nouvelle pour la suite.
✓Le compositeur écrivait dans
ses mémoires :
« Je n'ai jamais eu à travailler pour arriver à écrire ces
pages complexes. » Il faisait toutefois quantité d'erreurs qui donnent du fil à retordre à ses éditeurs.
✕Alors que le
compositeur écrivait dans ses mémoires : « Je n'ai jamais eu à travailler
pour arriver à écrire ces pages complexes », il faisait toutefois quantité d'erreurs qui donnent du fil à retordre à ses éditeurs.
Position des guillemets et début de la citation : Il faut souvent décider si tous les mots d'une phrase à citer doivent figurer à l'intérieur des guillemets, ou si certains mots moins signifiants (articles, pronoms, conjonctions, etc.) auraient avantage à faire partie du texte hôte pour permettre une insertion plus souple. En d'autres mots, le guillemet ouvrant peut être placé ailleurs qu'au tout début de la citation, à condition que les mots qui précèdent ne soient pas sufisamment originaux pour être considérés comme des mots cités.
➨Phrase
de départ : Je me suis toujours senti très proche des
courants les plus modernistes de la musique même si, dans mes propres
œuvres, je n'ai jamais réussi à aller aussi loin que ne
l'auraient souhaité certains critiques.
➨Le
compositeur disait qu'il s'était « toujours senti très
proche des courants les plus modernistes ». {correct}
➨Le
compositeur disait qu'il s'était toujours senti « très
proche des courants les plus modernistes ». {meilleur}
Lien syntaxique ou grammatical : Une citation incorporée à une phrase doit s'y intégrer souplement, donc sans créer de rupture syntaxique ou grammaticale, par exemple en introduisant un manque de concordance entre le sujet de la phrase qui introduit la citation et la citation elle-même. Les deux citations tirées de l'exemple donné au paragraphe précédent s'intègrent très bien. Cependant, on pourrait citer la phrase entière de deux façons : la première modifie certains mots pour les adapter, tandis que la seconde (qui est possible, mais pourrait faire froncer les sourcils à certains auteurs), conserve l'adjectif possessif et le pronom de la source. La solution idéale, évidemment, serait ici d'introduire la citation par un deux-points.
➨Le
compositeur disait qu'il s'était « toujours senti très
proche des courants les plus modernistes de la musique même si, dans
[s]es propres œuvres, [il n'a] jamais réussi à aller aussi
loin que ne l'auraient souhaité certains critiques ».
➨Le
compositeur disait qu'il s'était « toujours senti très
proche des courants les plus modernistes de la musique même si, dans
mes propres œuvres, je n'ai jamais réussi à aller aussi
loin que ne l'auraient souhaité certains critiques ».
On peut aussi incorporer une citation consistant en la fin d'une phrase et tout ou partie de la phrase suivante. Toutefois, cette technique pourrait ne pas être du goût de tous les stylistes. Comme la citation se termine par une phrase complète, il est préférable (même si diverses sources recommandent le contraire) de placer la ponctuation finale avant le guillemet, puisque la phrase qui termine la citation est complète.
➨Elle trouvait que ce piano l'empêchait « de donner sa pleine mesure. C'est une honte de n'avoir rien de mieux à offrir aux artistes que l'on invite. »
Cas particuliers
Citation en langue étrangère : On cite généralement dans la langue du texte en donnant l'original en note et en appliquant les conventions typographiques de la publication hôte. Les éditeurs d'ouvrages s'adressant principalement à des spécialistes pourraient décider de citer directement l'original sans donner de traduction. De plus, un texte publié dans une revue bilingue pourrait ainsi se passer de traduction. Toutefois, le fort contraste provoqué par l'insertion d'un passage dans une autre langue suggère que cette pratique n'est peut-être pas idéale.
✓L'auteur
insiste sur cette habitude qu'avait le compositeur « de répondre
à ses critiques en les abreuvant d'insultes ».
✕L'auteur
insiste sur cette habitude qu'avait le compositeur « to respond
to his critics by showering insults on them ».
Citation d'après un autre auteur : On peut reprendre les propos d'un auteur tels que cités dans un ouvrage et fournir une note à cet effet (« X, cité dans Y »). La technique idéale consiste cependant à consulter soi-même la source pour s'assurer de l'exactitude de la citation en la lisant dans son contexte et de son à-propos pour le texte. On cite ensuite soi-même à partir de l'original, peut-être en procédant avec plus de pertinence.
Utilisation des crochets : On place habituellement entre crochets un changement de casse requis pour fondre le passage cité dans son texte ou encore pour indiquer qu'un pronom a été remplacé par un nom ou qu'un temps de verbe a été remplacé par un autre temps. Il est aussi possible de commencer la citation à un autre endroit pour éviter l'utilisation des crochets. Ceci dit, on peut décider, à moins qu'il ne s'agisse de rédaction dans un contexte légal, de simplement changer le casse étant donné que le sens de la phrase n'est pas altéré.
➨Phrase
de départ : Il s'agissait de la pire interprétation
qu'il nous a proposée à ce jour.
➨Il
considérait qu'« [i]l s'agissait de la pire interprétation
qu'il nous a proposée à ce jour ». {utilisation des crochets}
➨Il
considérait qu'il s'agissait de « la pire interprétation
qu'il nous a proposée à ce jour ». {appropriation de quelques mots du passage cité qui n'apportent aucune originalité à la citation elle-même}
➨Il
considérait qu'« il s'agissait de la pire interprétation
qu'il nous a proposée à ce jour ». {changement de casse tacite}
Les crochets servent aussi à ajouter une explication ou une précision. Dans ce cas, il faut placer ces ajouts à un endroit grammaticalement clair.
✓Sorabji
lui avait joué [à Busoni] sa première sonate pour piano
en privé.
✕Sorabji
lui [Busoni] avait joué sa première sonate pour piano en privé.
Enfin, les crochets mettent en relief une ponctuation manquante. Si ce genre de précision témoigne du soin apporté à la reproduction d'un passage donné, on peut se demander si elle reste souhaitable dans le cas d'une édition de textes manuscrits peu soignés où il faudrait multiplier les crochets au point que la lecture deviendrait pénible. Il s'agit dans un tel cas de fournir les explications relatives aux modifications apportées de manière tacite dans une section d'introduction. Décider de ce qui sera identifié de manière tacite ou sera identifié avec précision et ensuite respecter sa méthode de façon rigoureuse est toujours un problème pour quiconque prépare une édition critique. Si l'on décide d'omettre les crochets dans la majorité des cas, il faut s'assurer qu'il sera possible de le faire jusqu'à la fin sans avoir à revenir en arrière et à les réinsérer.
➨La dernière exécution de cette œuvre magistrale, que nous entendons trop rarement[,] remonte à 20 ans.
Erreurs dans la source ([sic] et [recte]) : Les mots latins sic et recte, qui s'écrivent en italique et que l'on place entre crochets pour marquer qu'il s'agit d'un ajout, permettent d'attirer l'attention sur une faute dans la source. Dans certains cas, il est souvent possible de corriger tacitement de simples coquilles, par exemple pour des citations provenant de journaux. Lorsqu'on cite des textes datant d'une époque où l'orthographe était très fluctuante ou si le contexte le justifie, on peut ajouter un avertissement indiquant que les textes sont reproduits tels quels, afin d'éviter une trop grande quantité de corrections qui rendraient la lecture ardue ou décider d'uniformiser ou de moderniser l'orthographe.
Le mot sic signale la présence d'une faute (généralement d'orthographe ou d'accord), tandis que le mot recte précède le mot qui aurait dû être choisi. On utilise recte lorsque la forme correcte risque de ne pas être connue, par exemple s'il s'agit d'un nom peu courant ou d'un mot dans une langue étrangère, et qu'il est important de la préciser.
➨Leopold
Godowsky a grandement contributé [sic] au développement
du jeu de la main gauche au piano.
➨Leopold
Godowski [recte Godowsky] a grandement contribué au développement
du jeu de la main gauche au piano.
Citation en début de paragraphe : Sauf dans le cas de citations en exergue (en tête d'un ouvrage ou d'un chapitre), il est généralement préférable d'amener la citation plutôt que de commencer un paragraphe par celle-ci.
Points d'omission
Trois points consécutifs placés entre crochets ([…]; Alt+0133 sous Windows) indiquent l'omission d'un passage plus ou moins long; les crochets permettent de marquer que ces points ne sont pas des points de suspension présents dans la source. Les contextes dans lesquels les points d'omission sont requis ou non sont les suivants :
Requis
- à l'intérieur d'une phrase, pour indiquer l'omission d'une partie plus ou moins longue;
- à la fin d'une citation, si l'on omet un ou plusieurs paragraphes avant de continuer à citer un ou plusieurs paragraphes subséquents;
- au début d'un paragraphe, après un renfoncement, si l'on en omet le début.
Non requis
- avant le premier mot d'une citation, même lorsque le début de la phrase est omis;
- après le dernier mot d'une citation, à moins que l'on ne veuille citer un paragraphe subséquent.
L'exemple suivant, qui provient d'un ouvrage ancien sur Palestrina (voir la note à la fin) et relate l'histoire de la naissance de sa Missa Papae Marcelli d'une façon appartenant plus à la légende qu'à la réalité, illustre les contextes qui peuvent se présenter. Les appels d'explication sont placés entre accolades en exposant avant les passages commentés.
{1}Quant aux chanteurs de la chapelle pontificale, vivement intéressés à la conservation de la musique moderne, ils devinrent justes envers un rival dangereux, bienveillans {2}[sic] même pour leur ancien camarade pensionné; et, d'accord avec les deux cardinaux {3}[Vitellozzo Vitelli et Carlo Borromeo], ils arrêtèrent unanimement que l'on chargerait Pierre-Louis de Palestrina d'écrire une messe purement ecclésiastique, purgée de tout souvenir profane dans le thème, dans les mélodies et dans la mesure; {4}[...] {5}[L]es deux cardinaux promirent que, si Palestrina réussissait dans cette entreprise, on ne porterait aucune atteinte à l'usage de la musique figurée dans les églises; {6}[...]
{7}Ce fut Charles Borromée qui se chargea de parler à Palestrina : il le fit venir chez lui et le pria de composer une messe qui remplit toutes les conditions indiquées, de telle sorte que sa sainteté et la congrégation des huit cardinaux pussent, sans être forcées de bannir la musique figurée de l'église, satisfaire cependant à ce qu'avait justement exigé le concile de Trente.
{8}[...] L'avenir de la musique moderne dépendait de lui, car, si à cette époque un ordre de la cour de Rome eût banni les combinaisons harmoniques de l'église, pour y rétablir exclusivement le plain-chant, les chapelles et les cathédrales d'où sont sortis tous les grands compositeurs de la fin du XVIe siècle et du commencement du XVIIe auraient cessé leur enseignement, et l'art se serait probablement perdu. {9}[...] Mais c'est à ce moment de sa vie que Palestrina prend dans l'histoire des arts, chez les modernes, un rang et une importance qu'aucun artiste n'a eus, je le répète[appel de note].
{1. Renfoncement au début puisque la citation commence ailleurs qu'au début du paragraphe (ne pas tenir compte de la présence de l'appel entre accolades)}
{2. Utilisation du [sic] pour indiquer que la source utilise cette forme inusitée}
{3. Ajout des noms des cardinaux entre crochets, car ils ont été mentionnés plus tôt dans la source}
{4. Points d'omission pour signaler l'omission d'un passage}
{5. Mise entre crochets de la première lettre de l'article les pour indiquer que la citation commence ailleurs qu'au début de la phrase}
{6. Points d'omission à la fin parce que la fin d'une phrase est omise}
{7. Renfoncement au début du paragraphe parce que la citation correspond à un début de paragraphe}
{8. Renfoncement au début du paragraphe et points d'omission pour montrer que l'on omet la partie initiale}
{9. Points d'omission pour signaler l'omission d'un passage}
[Note] E.-J. Delécluze, Palestrina (Paris : Imprimerie de H. Fournier, 1842), 32-33; repris dans T. J. de Vroye et X. van Elewyck, De la musique religieuse : Les congrès de Malines (1863 et 1864) et de Paris (1860) et la législation de l'Église sur cette matière (Paris : Librairie Lethielleux; Louvain : Typ. Vanlinthout Frères; Bruxelles : Librairie Auguste Decq, 1866): 293.
Accueil | À
propos du site | Pages essentielles | Bibliographie
Aide | Plan du site | Liste alphabétique des noms de fichiers
Modifications
écentes et nouvelles | Commentaires | Au
sujet de l'auteur
Prix
pour la promotion d'une langue de qualité dans l'enseignement collégial
et universitaire
Gala
des Mérites du français 2003 de l'Office québécois
de la langue française
Le GDRM décline toute responsabilité quant à la validité et à la pérennité des liens Internet fournis
ainsi qu'à l'exactitude et au caractère des données qu'ils renferment.
© Marc-André Roberge 2026
Faculté de musique, Université Laval, Québec